

L’oreille est l’organe sensoriel de l’audition et du maintien de l’équilibre par la perception de la position du corps et des mouvements de la tête. Elle comprend trois parties: l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne. La première est extracrânienne alors que les deux autres sont incluses dans l’os temporal, (ou rocher) (voir figure 11.1).
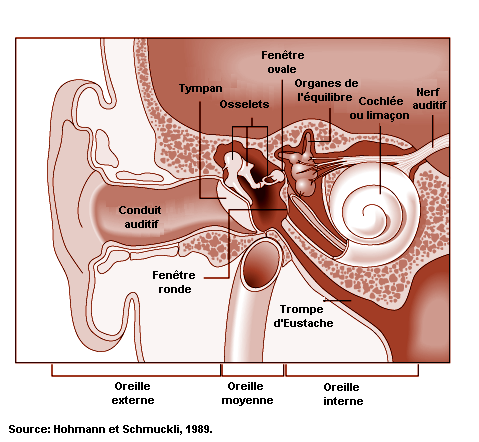
L’oreille externe se compose du pavillon de l’oreille, formé par un cartilage recouvert de peau, et du conduit auditif externe, cylindre irrégulier d’environ 25 mm de long qui est bordé de glandes sécrétant de la cire.
L’oreille moyenne consiste en une cavité dont la paroi externe est formée par la membrane tympanique (tympan). Cette cavité remplie d’air contient les osselets et communique en avant avec le rhino-pharynx par la trompe d’Eustache qui permet l’équilibre de pression de part et d’autre du tympan. Cela explique, par exemple, comment le fait d’avaler permet l’égalisation des pressions et le retour de l’acuité auditive altérée par un changement brusque de la pression barométrique (comme c’est le cas au cours d’un atterrissage ou lors de la montée ou de la descente dans un ascenseur rapide). La chaîne des osselets — marteau, enclume, étrier — relie le tympan à l’oreille interne par la platine de l’étrier, qui est mobile et s’insère au niveau de la fenêtre ovale. La chaîne des osselets est placée sous le contrôle de muscles (muscle tenseur du tympan et muscle stapédien).
L’oreille interne contient les organes sensoriels. Elle est constituée par une coque osseuse, appelée labyrinthe osseux, contenant le labyrinthe membraneux. Celui-ci comprend un ensemble de cavités réalisant un système clos rempli d’endolymphe, liquide riche en potassium. Le labyrinthe membraneux est séparé du labyrinthe osseux par la périlymphe, liquide riche en ions sodium.
Le labyrinthe osseux comprend deux parties. L’une, antérieure, s’appelle la cochlée et a une forme de spirale dirigée vers l’avant, qui rappelle la forme d’un limaçon. Il s’agit de l’organe de l’audition. L’autre, postérieure, est formée par le vestibule et les canaux semi-circulaires et représente l’organe de l’équilibre. Les éléments neurosensoriels sont situés dans les différentes parties du labyrinthe membraneux: l’organe de Corti se trouve dans le canal cochléaire, tandis que les macules de l’utricule et du saccule, ainsi que les crêtes ampullaires des canaux semi-circulaires se trouvent dans la partie postérieure.
Le canal cochléaire est un tube dont la coupe transversale est triangulaire, formant une spirale de deux tours et demi. D’une part, il est relié à un épaulement de la columelle (lame spirale), de l’autre, il est accolé à la paroi osseuse de la cochlée. Il sépare ainsi la rampe vestibulaire de la rampe tympanique.
La rampe vestibulaire est fermée par la fenêtre ovale (platine de l’étrier) et la rampe tympanique se termine à la fenêtre ronde. Ces deux rampes communiquent au niveau de l’hélicotréma, sommet de la cochlée. La membrane basilaire constitue le bord inférieur du canal cochléaire. Elle supporte sur toute sa longueur l’organe de Corti chargé de la transmission des stimuli sonores. Séparées par de nombreuses cellules de soutien, les cellules sensorielles à proprement parler comptent, d’une part, une rangée d’environ 3 500 cellules ciliées internes qui forment des synapses avec environ 90% des 30 000 neurones auditifs primaires, et, d’autre part, trois rangées de cellules ciliées externes qui représentent les 15 000 cellules ciliées de l’organe de Corti (voir figure 11.2). Leurs cils traversent une membrane extraordinairement mince et sont enchâssés dans la membrane tectoriale, qui se termine librement au-dessus de ces cellules. La membrane de Reissner forme la limite supérieure du canal cochléaire.
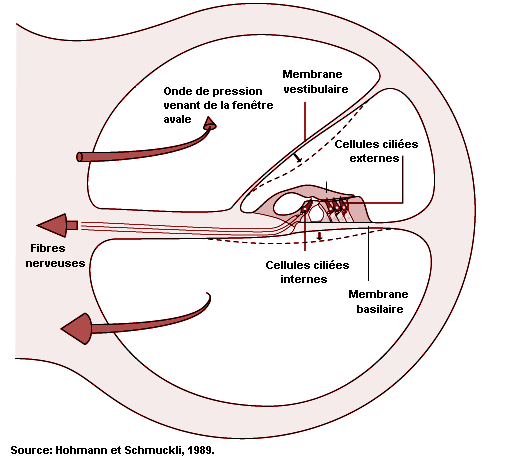
Les corps des cellules sensorielles, qui reposent sur la membrane basilaire, sont entourés par les extrémités des fibres nerveuses, dont les axones, au nombre de 30 000 environ, forment le nerf cochléaire, qui traverse le conduit auditif interne pour aller jusqu’aux structures centrales du tronc cérébral, phylogénétiquement la partie la plus ancienne du cerveau. Après un trajet complexe, les voies auditives atteignent la partie du cortex cérébral qui est chargée de la perception des stimuli acoustiques (aire temporale).
C’est au niveau des crêtes ampullaires des canaux semi-circulaires et des macules de l’utricule et du saccule que sont localisées les cellules sensorielles. Les excitations qui parviennent à ces cellules résultent de la pression exercée sur elles par l’endolymphe à la suite des déplacements de la tête et du corps. Ces cellules sensorielles sont en rapport avec des cellules bipolaires dont les prolongements périphériques constituent le nerf utriculaire (canaux semi-circulaires antérieur et externe) et le nerf sacculaire (canal semi-circulaire postérieur). Ces deux nerfs pénètrent dans le conduit auditif interne et forment, après réunion, le nerf vestibulaire. Joint au nerf cochléaire, celui-ci devient le huitième nerf crânien appelé nerf auditif.
Le nerf vestibulaire atteint le tronc cérébral au niveau des noyaux vestibulaires, d’où partent des fibres qui se dirigent vers le cervelet, vers les nerfs commandant les mouvements des yeux et vers la moelle épinière.
L’organe de l’ouïe est formé de deux éléments: un conducteur du son (oreille externe et moyenne) et un récepteur (oreille interne).
En passant par le conduit auditif externe, les ondes sonores frappent le tympan qui se met à vibrer et qui transmet ensuite ses mouvements à l’étrier par l’intermédiaire du marteau et de l’enclume. Le rapport de la surface tympanique (55 mm2) à la surface de la platine de l’étrier (3,5 mm2), ainsi que l’articulation en leviers des osselets entraînent une amplification de la pression sonore de vingt-deux fois. En raison de la fréquence propre de l’oreille moyenne, le rapport de transmission est maximal entre 1 000 et 2 000 Hz. Les mouvements de la platine de l’étrier donnent naissance à des ondes dans le liquide de la rampe vestibulaire. Le liquide étant incompressible, chaque mouvement vers l’intérieur de la platine de l’étrier est suivi d’un mouvement de la fenêtre ronde en direction de l’oreille moyenne.
Lors d’exposition à un niveau sonore élevé, le muscle de l’étrier se contracte et protège ainsi l’oreille interne (réflexe stapédien). Les muscles de l’oreille moyenne ont d’autres fonctions: étendre la gamme dynamique de l’oreille, améliorer la localisation des sources sonores, diminuer la résonance de l’oreille moyenne, régler la pression aérienne dans l’oreille moyenne et la pression liquidienne dans l’oreille interne.
Dans une gamme de fréquences comprises entre 250 et 4 000 Hz, le seuil du réflexe stapédien se situe à environ 80 décibels (dB) au-dessus du seuil d’audition et son amplitude croît avec le niveau de la stimulation (de 0,6 dB/dB environ). La latence de ce réflexe est de 150 ms au seuil et de 24 à 35 ms en présence de bruits de forte intensité. La contraction des muscles de l’oreille moyenne réduit de 10 dB environ la transmission des sons (pour les fréquences inférieures à la résonance principale de l’oreille moyenne). En raison de sa latence, le réflexe stapédien ne peut protéger l’oreille interne des bruits impulsionnels qui se présentent isolément; en revanche, il devient efficace quand ces bruits sont générés à une fréquence supérieure à 2 ou 3 impulsions par seconde.
Au niveau de l’oreille, la vitesse de propagation des ondes dépend de l’élasticité de la membrane basilaire qui augmente de la base au sommet. Par conséquent, la vitesse de l’onde décroît en direction du sommet. Le transfert d’énergie de la vibration à la membrane de Reissner et à la membrane basilaire dépend de la fréquence. Pour les fréquences aiguës, l’amplitude de l’onde est maximale à la base, tandis que pour les fréquences graves elle l’est au sommet. Ainsi, l’excitation mécanique maximale se localise en un point de la cochlée qui dépend de la fréquence, ce qui permet la discrimination fréquentielle des sons. Les mouvements de la membrane basilaire induisent des cisaillements des stéréocils des cellules ciliées et entraînent une série d’événements mécaniques, électriques et biochimiques qui constituent la transmission mécanosensorielle et la première étape de l’analyse du signal acoustique. Les cisaillements des stéréocils provoquent en effet l’ouverture de canaux ioniques, qui modifie la perméabilité des membranes cellulaires et permet la pénétration des ions potassium à l’intérieur des cellules, entraînant ainsi leur dépolarisation et la génération des potentiels d’action.
Cette dépolarisation provoque la libération de neuromédiateurs au pôle synaptique des cellules ciliées internes et donne naissance aux influx nerveux qui vont parcourir les fibres afférentes du nerf auditif en direction des centres supérieurs. L’intensité de la stimulation auditive dépend du nombre de potentiels d’action par unité de temps et du nombre de cellules stimulées, alors que la fréquence avec laquelle le son est perçu dépend des populations de fibres nerveuses mises en jeu. Les différentes fréquences du son ont chacune une représentation spatiale différente dans le cortex cérébral (tonotopie).
Les cellules ciliées internes sont des mécanorécepteurs qui transforment les signaux produits par les vibrations acoustiques en messages envoyés au système nerveux central, mais ce ne sont pas elles qui assurent à l’oreille ni sa sensibilité au seuil ni sa remarquable sélectivité en fréquences.
Les cellules ciliées externes n’envoient pas de message auditif au cerveau. Elles amplifient sélectivement les vibrations mécano-acoustiques près du seuil (d’un facteur 100 environ, soit 40 dB) et permettent ainsi (vraisemblablement par couplage micromécanique via la membrane tectoriale) l’excitation des cellules ciliées internes. Les cellules ciliées externes peuvent produire davantage d’énergie qu’elles n’en reçoivent du milieu extérieur et se contracter activement à des fréquences très élevées, jouant ainsi le rôle d’amplificateur cochléaire.
Au niveau de l’oreille interne, l’interférence entre les cellules ciliées externes et les cellules ciliées internes, constituant une boucle de rétroaction, permet de régler le fonctionnement du récepteur auditif et, en particulier, sa sensibilité au seuil, de même que sa sélectivité fréquentielle. Les efférences cochléaires peuvent ainsi agir en réduisant les dommages occasionnés par une exposition de la cochlée à des sons intenses. Il peut également se produire une contraction réflexe des cellules ciliées externes induite par le stimulus acoustique. Le réflexe stapédien de l’oreille moyenne qui réagit aux basses fréquences et la contraction réflexes de l’oreille interne qui répond aux fréquences élevées sont donc deux mécanismes de protection complémentaires.
Les ondes sonores peuvent également être transmises par les os du crâne. Deux mécanismes physiologiques sont envisagés.
Le premier repose sur l’hypothèse que les ondes de compression agissent sur le crâne et qu’en raison de l’incompressibilité de la périlymphe les deux rampes font respectivement bomber la fenêtre ovale ou la fenêtre ronde. En raison de la différence d’élasticité des fenêtres, le mouvement de l’endolymphe n’est pas uniforme et entraîne un mouvement de la membrane basilaire.
L’autre mécanisme possible est fondé sur le principe de l’inertie: comme seule la rampe vestibulaire est chargée par la masse des osselets, un mouvement de translation est créé, entraînant un déplacement de la membrane basilaire.
La conduction osseuse est normalement de 30 à 50 dB inférieure à la conduction aérienne, ce que l’on peut aisément constater en se bouchant les deux oreilles. Cela n’est cependant valable que pour une excitation par son aérien; une excitation par contact direct sur un os crânien donnera d’autres valeurs d’atténuation.
Les vibrations mécaniques font apparaître des variations de potentiels dans l’oreille interne, les voies et les centres nerveux. La sensation auditive n’existe qu’aux fréquences comprises entre 16 et 25 000 Hz et pour des pressions sonores variant, selon la fréquence considérée, de 20 µPa à 20 Pa (1 Pa = 1 pascal = 1 N/m2 = 10 µbar). Cela correspond à un rapport de pression de 1 à 1 million! Le seuil d’audibilité d’une pression sonore donnée dépend de la fréquence. Il est minimal entre 1 000 et 6 000 Hz et il augmente vers les fréquences supérieures et inférieures.
Pour des raisons pratiques, une unité de mesure qui reflète notre perception de l’intensité sonore, en référence au seuil auditif, a été choisie selon une échelle logarithmique: le niveau de pression acoustique exprimé en décibels (dB). Ainsi, 20 µPa correspondent à 0 dB. La pression acoustique est multipliée par 10 lorsque le niveau s’élève de 20 dB, cela en raison de la formule suivante:
Lx = 20 log Px/Po
Lx= niveau acoustique en dB
Px= pression acoustique en pascals
Po= pression acoustique de référence
(2 × 10-5 pascal, seuil de l’audition)
Le seuil de discrimination des fréquences, c’est-à-dire des différentes hauteurs du son, est d’environ 1,5 Hz jusqu’à 500 Hz, tandis qu’il reste constant à 0,3% pour les fréquences supérieures. Le seuil de discrimination des différences de pression sonore est d’environ 20% près du seuil auditif. Pour des pressions sonores élevées, des différences de 2% seront déjà perçues.
Si l’intervalle de fréquence entre deux sons est trop petit, on n’entend qu’un seul son dont le niveau varie et dont la fréquence perçue se situe entre les deux fréquences initiales. Un effet de masque se produit lorsque deux sons isolés ont des fréquences proches, mais des pressions différentes. Si la différence de pression sonore est suffisamment grande, seul le son le plus fort est perçu, alors que le plus faible est masqué.
La localisation du son n’est possible que si les deux organes auditifs sont intacts, de sorte que la différence de temps de parcours de la pression sonore entre les deux oreilles puisse être perçue. La plus petite différence de temps encore détectable est de 3 × 10-5 s. La différence d’intensité entre les deux oreilles, résultant de l’effet d’écran de la tête, aide aussi à la localisation de la source sonore.
La capacité de résolution de l’ouïe humaine est remarquable. Elle est basée sur la décomposition des fréquences dans l’oreille interne et surtout sur leur analyse dans le cerveau. L’oreille interne peut ainsi percevoir et identifier chaque source sonore individuelle, telle que chaque instrument de musique provenant d’un signal acoustique aussi complexe que celui de la musique d’un orchestre symphonique tout entier.
Lorsque l’ouïe est soumise à des stimuli sonores intenses, le déplacement des cils excède leur résistance mécanique et conduit à la destruction mécanique des cellules ciliées qui, rappelons-le, sont en nombre limité. Ces cellules étant incapables de se régénérer, toute destruction de ce petit contingent est donc définitive et progressive si l’exposition à la nuisance sonore se poursuit. En général, la destruction des cellules ciliées s’accompagne finalement d’un déficit auditif.
Les cellules ciliées externes sont celles qui sont le plus sensibles au traumatisme sonore, ainsi qu’à d’autres facteurs de nature toxique, tels que l’anoxie, les médicaments ototoxiques (dérivés de la quinine, streptomycine, quelques autres antibiotiques, certaines chimiothérapies antitumorales); c’est pourquoi, en cas d’agression, elles sont les premières à être détruites. Or, les cellules qui sont lésées ou dont les stéréocils sont détruits ne sont plus le siège que de phénomènes hydromécaniques passifs et, dans ces conditions, seule une analyse grossière de la vibration acoustique est possible. En bref, la destruction des structures ciliaires des cellules ciliées externes entraîne une élévation du seuil auditif de l’ordre de 40 dB.
Le bruit, surtout si l’exposition est répétée ou de longue durée, peut aussi perturber le métabolisme des cellules de l’organe de Corti, ainsi que celui des synapses afférentes, situées sous les cellules ciliées internes. Parmi les atteintes extraciliaires qui sont décrites dans la littérature, on trouve des modifications de l’ultra-structure (réticulum, mitochondries, lysosomes) et, dans la région postsynaptique, un gonflement des dendrites afférentes. Ce gonflement est vraisemblablement dû à l’accumulation toxique de neurotransmetteurs, conséquence de l’excès d’activité des cellules ciliées internes stimulées par le bruit. C’est néanmoins l’ampleur de la destruction des stéréocils qui suffit à déterminer le caractère temporaire ou définitif de l’atteinte de l’ouïe.
A l’époque actuelle, dans une société industrielle de plus en plus complexe, le bruit d’origine professionnelle est une sérieuse menace pour l’ouïe. L’exposition au bruit est responsable d’environ un tiers des 28 millions de cas d’atteintes auditives aux Etats-Unis. Selon l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail (National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)), 14% des travailleurs américains sont soumis à des niveaux de bruit potentiellement dangereux, dépassant 90 dB. Le bruit est donc la nuisance professionnelle la plus répandue. L’exposition au bruit est la deuxième cause d’atteinte auditive après les effets liés à l’âge. Enfin, on ne doit pas oublier la contribution du bruit à la perte d’audition dans des circonstances extraprofessionnelles, telles que le bricolage, la musique suramplifiée (surtout lors du port d’écouteurs), le tir, etc.
Le traumatisme sonore aigu. L’effet immédiat des stimuli sonores de forte intensité (une explosion, par exemple) peut se traduire par une élévation du seuil auditif, une rupture du tympan et des lésions de l’oreille moyenne et de l’oreille interne (dislocation des osselets, lésion cochléaire ou fistules).
Le déplacement temporaire du seuil d’audition (fatigue auditive). Après une exposition au bruit, la sensibilité des cellules sensorielles diminue en fonction de la durée et de l’intensité de ce bruit. Au début, l’élévation du seuil d’audition est totalement réversible, mais persiste pendant un temps limité après la fin de la stimulation. C’est ce que l’on appelle la fatigue auditive ou déplacement temporaire du seuil d’audition (désigné par le sigle anglais TTS).
L’étude de la récupération de la sensibilité auditive permet de distinguer plusieurs types de fatigue auditive. La fatigue à court terme se dissipe en moins de deux minutes et se traduit par un déplacement maximum du seuil à la fréquence d’exposition. La fatigue à long terme est caractérisée par une durée de récupération supérieure à deux minutes, mais inférieure à seize heures, limite arbitraire fondée sur l’étude de l’exposition à des bruits industriels. En général, la fatigue auditive est fonction de l’intensité, de la durée, de la fréquence et de la continuité de la stimulation. C’est ainsi que pour une dose donnée de bruit, résultant de l’intégration de son intensité et de sa durée, un bruit discontinu est moins dangereux qu’un bruit continu.
L’amplitude du TTS augmente en moyenne de 6 dB chaque fois que celle de la stimulation double. A partir d’une certaine intensité d’exposition (niveau critique), cette augmentation s’accélère, particulièrement pour les bruits impulsionnels. Le TTS augmente de manière asymptotique avec la durée d’exposition; la valeur asymptotique elle-même augmente avec l’intensité de la stimulation. Du fait de la fonction de transfert de l’oreille externe et de l’oreille moyenne, les basses fréquences sont les mieux tolérées.
Sur la base d’études portant sur des expositions à des sons purs, on a observé que le maximum du TTS se décale progressivement vers les fréquences supérieures à celle de la stimulation sonore au fur et à mesure que le niveau de cette dernière augmente. Un sujet exposé à un son pur de 2 000 Hz développe une fatigue auditive qui est maximale à 3 000 Hz environ (décalage d’une demi-octave). Il est possible que ce phénomène soit dû à l’effet du son sur les cellules ciliées externes.
Le travailleur qui présente un TTS recouvre en général une audition normale dans les heures qui suivent la cessation de l’exposition au bruit. Mais l’exposition répétée au bruit entraîne une moins bonne récupération et induit une atteinte auditive définitive.
Le déplacement permanent du seuil d’audition (atteinte auditive définitive). Lorsque l’exposition à des intensités sonores élevées dure des années, la perte d’audition peut devenir définitive. On parle alors de déplacement permanent du seuil d’audition (désigné par le sigle anglais PTS). Du point de vue anatomique, cette perte d’audition correspond à une dégénérescence des cellules ciliées, caractérisée au début par de légères altérations histologiques, pour aboutir ensuite à la destruction cellulaire complète. La perte de l’ouïe est plus susceptible de survenir aux fréquences pour lesquelles la sensibilité de l’oreille est la meilleure; c’est en effet pour ces fréquences que l’énergie acoustique est transmise de façon optimale du milieu extérieur à l’oreille interne. Cela explique l’atteinte débutant à 4 000 Hz, caractéristique des surdités profes- sionnelles (voir figure 11.3). Les effets du niveau et de la durée de la stimulation sont interdépendants et, pour l’établissement de normes internationales, on considère que l’importance des déficits auditifs est liée à la quantité d’énergie acoustique reçue par l’oreille (dose de bruit).

Le développement de la surdité due au bruit n’est pas le même chez tous les individus. On a cherché à expliquer cette sensibilité individuelle en prenant en compte différentes variables qui semblaient devoir jouer un rôle, telles que l’âge, le sexe, la race, la présence d’une maladie cardio-vasculaire ou des habitudes tabagiques, etc. Tout cela sans pouvoir conclure.
Une question intéressante est celle de savoir si les personnes qui présentent un TTS supérieur à la moyenne seront celles qui développeront plus tard un PTS également supérieur à la moyenne. On a vu plus haut que le TTS se décale progressivement vers des fréquences supérieures à celle de la stimulation. D’autre part, la plus grande partie des dégâts ciliaires se produisant aux fortes intensités affecte des cellules qui sont sensibles à la fréquence de la stimulation. Si l’exposition se prolonge, on voit se rapprocher progressivement la fréquence à laquelle la perte d’audition définitive est maximale et la fréquence de la stimulation (alors que dans la fatigue auditive, la perte d’audition temporaire maximale se déplace vers des fréquences supérieures à celle de la stimulation acoustique). Les lésions ciliaires et les destructions cellulaires sont alors situées dans les zones de fréquence correspondant aux pertes auditives. On en déduit ainsi que la fatigue et les pertes auditives résultent de mécanismes différents et qu’il n’est pas possible de prédire un PTS à partir de la mesure d’un TTS chez un sujet donné.
Les individus souffrant d’un PTS sont en principe asymptomatiques au départ. Au fur et à mesure que le déficit auditif s’installe, ils ont du mal à suivre les conversations en milieu bruyant, lors de réceptions ou au restaurant, par exemple. Ce phénomène progressif, qui se manifeste au début par une difficulté à entendre les sons aigus, est en général sans douleur et d’installation lente.
Le questionnaire médical doit non seulement préciser la date éventuelle à laquelle le déficit auditif a été diagnostiqué et comment il a évolué, mais aussi l’âge, les antécédents familiaux, la prise de médicaments ototoxiques, l’exposition au bruit, la symétrie entre les deux oreilles, l’association à des sifflements ou des bourdonnements dans les oreilles (acouphènes), des vertiges ou d’autres troubles neurologiques, ainsi que la présence d’infections de l’oreille avec douleur et écoulement au niveau du conduit auditif externe. L’anamnèse doit insister sur l’exposition durable aux sons de fort niveau (en se souvenant que, pour le patient, tous les sons ne sont pas des bruits), cela aussi bien au poste de travail actuel qu’aux postes occupés antérieurement ou dans la vie courante. Des épisodes de TTS confirmeraient des expositions ototoxiques antérieures.
L’examen physique portera sur l’état des nerfs crâniens et de la fonction du cervelet, complété par une ophtalmoscopie pour déceler des signes éventuels d’augmentation de la pression intracrânienne. Une tympanoscopie permettra de mettre en évidence et de retirer d’éventuels bouchons de cérumen (sans objet pointu pour ne pas léser le tympan), après quoi on recherchera des traces de cicatrices ou de perforation de la membrane tympanique. On peut déterminer grossièrement la perte auditive par un test clinique courant qui consiste à faire répéter des mots et des phrases, émis à voix basse par le médecin, qui se place derrière le patient ou hors de sa vue. Le test de Weber (où l’on place un diapason sur le milieu du front pour vérifier si le son est transmis également dans les deux oreilles) et le test de Rinné (qui consiste à poser un diapason sur la mastoïde jusqu’à ce que le son ne soit plus perçu et à le déplacer alors brusquement devant le canal auditif; souvent, le son est perçu plus longtemps par voie aérienne que par voie osseuse) vont permettre de conclure si on a affaire à une surdité de transmission ou à une surdité de perception.
L’audiométrie est le test classique utilisé pour détecter et évaluer le déficit auditif (voir ci-dessous). En fonction des constatations, on fera appel, sur conseil de différents spécialistes, à des examens complémentaires (tympanométrie, audiométrie vocale, exploration du réflexe stapédien), des analyses de laboratoire, des examens électrophysiologiques (électrocochléogramme, potentiels évoqués auditifs) et radiologiques (scanner, résonance magnétique).
C’est un examen crucial dans l’évaluation médicale, qui détermine à l’aide d’un audiomètre le seuil d’audition de sons purs de fréquences variées situées entre 250 et 8 000 Hz, pour des intensités sonores s’échelonnant de –10 dB (seuil d’audition pour une oreille intacte) à 110 dB (atteinte maximale). La personne examinée ne doit pas avoir été exposée dans les seize heures qui précèdent (pour éliminer des TTS). L’audition est contrôlée séparément pour chaque oreille. Elle permet de mesurer la conduction aérienne, en plaçant les écouteurs sur les oreilles, et la conduction osseuse, en utilisant un vibrateur mis en contact avec le crâne, derrière l’oreille. Le résultat est reporté sur un graphique appelé audiogramme (voir figure 11.3). L’examen est en général complété par une audiométrie vocale, qui définit un seuil d’intelligibilité, c’est-à-dire l’intensité à laquelle la parole est reconnue comme intelligible, en utilisant des mots de deux syllabes d’égale intensité (par exemple, bouchon, souper, rondin).
La comparaison de la conduction aérienne et de la conduction osseuse permet de définir si le déficit auditif est dû à une lésion du conduit auditif externe ou de l’oreille moyenne (surdité de transmission), ou s’il s’agit d’une lésion de l’oreille interne ou du nerf auditif (surdité de perception neurosensorielle) (voir figures 11.3 et 11.4). Lors de l’atteinte de l’ouïe due au bruit, l’audiogramme présente des caractéristiques particulières (voir figure 11.3). La perte de l’ouïe débute à 4 000 Hz sous la forme d’une encoche sur le tracé de l’audiogramme. Si l’exposition à un bruit trop intense se poursuit, les fréquences voisines seront progressivement touchées et l’encoche s’élargira pour empiéter, aux environs de 3 000 Hz, sur la zone critique pour la conversation. L’atteinte touche habituellement de manière symétrique les deux oreilles, c’est-à-dire que la différence entre celles-ci ne dépasse pas 15 dB à 500, 1 000 et 2 000 Hz ou 30 dB à 3 000, 4 000 et 6 000 Hz. Dans certains cas, l’atteinte peut être asymétrique parce que l’exposition au bruit n’est pas uniforme. C’est l’exemple du tireur au fusil chez qui la perte peut être plus marquée pour le côté opposé au doigt qui actionne la gâchette (à gauche pour un droitier). Les atteintes de l’oreille qui ne sont pas en relation avec le bruit sont en général unilatérales et l’audiogramme ne montre pas l’encoche typique à 4 000 Hz (voir figure 11.4).
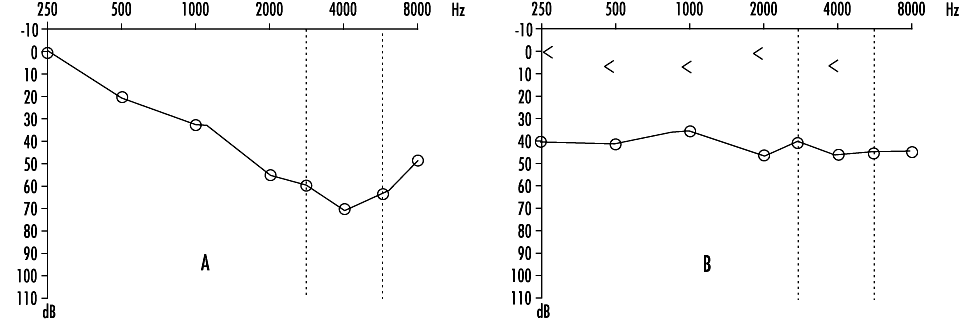
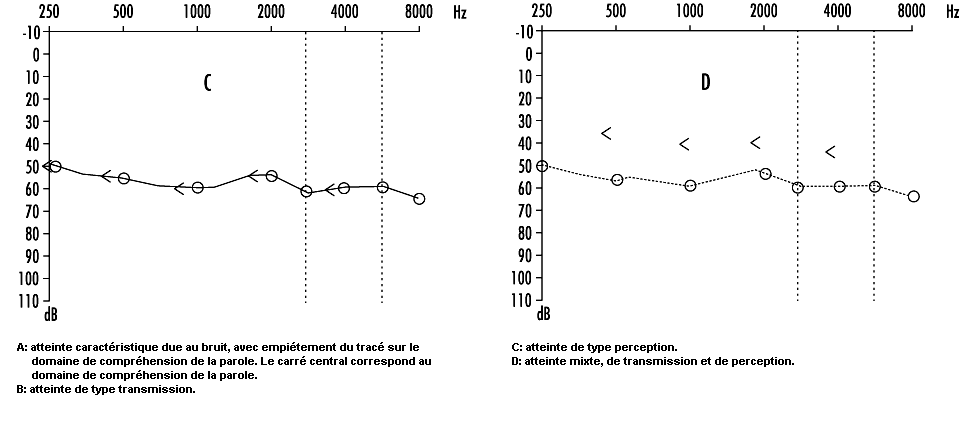
Il existe deux types d’examen audiométrique: l’audiométrie clinique et le dépistage audiométrique. L’audiométrie collective s’applique à des groupes d’individus, au travail, dans les écoles ou dans les collectivités, en vue de dépister ceux qui semblent souffrir d’un déficit de l’audition. La mesure est faite à l’aide d’audiomètres électroniques qui permettent parfois au sujet lui-même de se tester et se pratique habituellement dans un endroit calme, sans qu’il s’agisse nécessairement d’une cabine audiométrique insonorisée et sans transmissions vibratoires. Ce type d’examen doit être considéré comme une orientation préalable en vue d’un diagnostic audiométrique qui réclamera la précision et la reproductibilité de la mesure. Le diagnostic est pratiqué par un technicien qualifié (audiologiste), de qui l’on exige parfois un diplôme. La qualité de la mesure, dans les deux types d’audiométrie, est tributaire du contrôle et de la calibration périodiques de l’appareillage.
Dans de nombreux pays, la surdité professionnelle donne lieu à réparation. C’est pourquoi de nombreux employeurs incluent l’audiométrie dans l’examen médical d’embauche afin de détecter des déficits dont un précédent employeur pourrait être responsable ou qui seraient dus à une exposition non professionnelle au bruit.
Le seuil auditif augmente progressivement avec l’âge, les fréquences les plus hautes étant les plus touchées (voir figure 11.3). On ne retrouve donc pas l’encoche caractéristique de la courbe à 4 000 Hz observée dans les déficits auditifs dus au bruit.
Aux Etats-Unis, la formule la plus largement acceptée pour mesurer la limitation fonctionnelle liée à la perte auditive est celle proposée en 1979 par l’Académie américaine d’otolaryngologie (American Academy of Otolaryngology (AAO)) et adoptée par l’Association médicale américaine (American Medical Associ-ation). Elle utilise une moyenne des valeurs concernant les fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 3 000 Hz (voir tableau 11.1). La limite inférieure à partir de laquelle on parle d’atteinte fonctionnelle est placée à une perte de 25 dB.
|
|
Fréquence |
||||||
|
|
500 Hz |
1 000 Hz |
2 000 Hz |
3 000 Hz |
4 000 Hz |
6 000 Hz |
8 000 Hz |
|
Oreille droite (dB) |
25 |
35 |
35 |
45 |
50 |
60 |
45 |
|
Oreille gauche (dB) |
25 |
35 |
40 |
50 |
60 |
70 |
50 |
|
Atteinte unilatérale |
|||||||
|
Pourcentage d’atteinte unilatérale = (moyenne dB à 500, 1 000, 2 000 et 3 000 Hz) – 25 dB (limite inférieure) × 1,5 |
|||||||
|
Exemple: |
|||||||
|
Atteinte bilatérale |
|||||||
|
Pourcentage de l’atteinte bilatérale = {(pourcentage de la perte unilatérale pour la meilleure oreille × 5) + (pourcentage de la perte unilatérale pour la moins bonne oreille)}/6 |
|||||||
|
Exemple: {(15 × 5) + 18,8}/6 = 15,6 (%) |
|||||||
Source: Rees et Duckert, 1994.
La presbyacousie ou la perte d’audition due au vieillissement se manifeste vers 40 ans et progresse graduellement avec l’âge. Généralement, il s’agit d’une atteinte bilatérale. En cas de presbyacousie, l’encoche typique de 4 000 Hz observée lors d’un déficit auditif induit par le bruit n’apparaît pas. Cependant, le tracé peut représenter le double effet de l’exposition au bruit et de l’âge.
La première des mesures est d’éviter toute autre exposition au bruit à un niveau potentiellement nocif (voir «La prévention» ci-dessous). Il est généralement admis que, lorsque l’exposition au bruit en milieu de travail cesse, le déficit auditif observé ultérieurement n’est pas plus important que celui dû au processus normal du vieillissement.
Alors que les surdités de transmission (celles liées, par exemple, à un traumatisme acoustique aigu) peuvent faire l’objet d’un traitement médical ou chirurgical, les surdités de perception secondaires au bruit sont hors de portée thérapeutique. Le seul «remède» proposé suivant la situation est l’utilisation d’une aide auditive. Celle-ci se justifie dans les cas où l’atteinte touche les fréquences critiques pour la compréhension de la parole (500 à 3 000 Hz). D’autres assistances, telles que la formation à la lecture labiale et les amplificateurs de sonnerie (pour le téléphone, par exemple) peuvent être envisagées.
Le fait que l’atteinte liée au bruit est définitive donne un poids fondamental à toutes les mesures préventives susceptibles de réduire l’exposition. Ces mesures comprennent la diminution du bruit à la source (conception de machines plus silencieuses ou insonorisation des locaux dans lesquels elles se trouvent) ou l’utilisation de moyens de protection individuelle tels que les tampons ou bouchons d’oreilles et les casques antibruit.
Dans le cas où on choisit des protections individuelles, il est impératif de s’assurer que les déclarations du fabricant sur leur efficacité sont justifiées et que les travailleurs les utilisent correctement et systématiquement.
En situant la valeur limite d’exposition au bruit en milieu professionnel à 85 dB(A), on vise la protection du plus grand nombre. Toutefois, du fait que les individus sont diversement sensibles au bruit (comme mentionné plus haut), il est préférable que le bruit auquel sont exposés les travailleurs se situe bien au-dessous de cette valeur. L’audiométrie périodique devrait faire partie du programme de surveillance médicale pour détecter le plus tôt possible les effets d’une exposition au bruit.
Les hypoacousies dues à la toxicité cochléaire d’un certain nombre de médicaments sont bien connues (Rybak, 1993). Toutefois, jusqu’à ces dix dernières années, on s’est assez peu intéressé aux effets des produits chimiques industriels sur l’ouïe. Les recherches récentes sur les troubles de l’audition d’origine chimique se sont concentrées sur les solvants, les métaux lourds et les produits chimiques provoquant une anoxie.
Solvants. Chez les rongeurs, des études ont mis en évidence une diminution de la sensibilité aux sons de fréquence élevée après des semaines d’exposition intense au toluène. Les études histopathologiques et des études portant sur la région auditive du cerveau ont montré un effet prépondérant sur la cochlée, avec lésions des cellules ciliées externes. Il a été constaté des effets semblables après exposition au styrène, aux xylènes et au trichloroéthylène. Le sulfure de carbone et le n-hexane peuvent aussi agir sur la fonction auditive, mais leurs effets semblent plutôt affecter les voies plus centrales (Johnson et Nylén, 1995).
Chez l’humain, plusieurs cas de lésions de l’appareil auditif avec troubles neurologiques sévères ont été signalés après inhalation volontaire de solvants («sniffing»). Dans des groupes de personnes exposées professionnellement à des mélanges de solvants, au n-hexane ou au sulfure de carbone, des effets à la fois cochléaires et centraux sur les fonctions auditives ont été signalés. Dans ces groupes, l’exposition au bruit était courante; toutefois, les effets sur l’audition ont été considérés supérieurs à ceux attribuables au bruit.
Jusqu’à maintenant, seules quelques études contrôlées (c’est-à-dire dans lesquelles on a pu séparer les deux types de risque: bruit et solvants) ont eu pour objectif la recherche d’une atteinte auditive chez les personnes exposées aux solvants, mais non exposées significativement au bruit. Dans une étude danoise, une augmentation statistiquement significative du risque d’hypoacousie déclarée spontanément à 1,4 (IC95%: 1,1-1,9) a été mise en évidence après une exposition aux solvants de cinq ans ou plus. Dans un groupe exposé à la fois aux solvants et au bruit, on n’a pas constaté d’effet additif dû aux solvants. Dans un sous-échantillon de la population étudiée, on a noté une bonne concordance entre les troubles auditifs déclarés et l’évaluation audiométrique de l’atteinte auditive (Jacobsen et coll., 1993).
Dans une étude hollandaise sur des travailleurs exposés au styrène, l’audiométrie a révélé des différences dose-dépendantes des seuils auditifs (Muijser et coll., 1988).
Une étude brésilienne a été faite sur les effets auditifs d’une exposition au bruit, au toluène associé au bruit et à des mélanges de solvants chez des travailleurs de l’imprimerie et de la fabrication des peintures. Par rapport à un groupe témoin non exposé, on a constaté une augmentation significative du risque de perte de sensibilité aux sons aigus dans les trois groupes exposés. Les risques relatifs étaient respectivement de 4 et de 5 pour l’exposition au bruit et aux mélanges de solvants. Dans le groupe exposé à la fois au toluène et au bruit, le risque relatif était de 11, ce qui indique une synergie entre les deux expositions (Morata et coll., 1993).
Métaux. Une étude américaine a analysé les effets du plomb sur l’ouïe chez des enfants et des adolescents. Une relation dose-dépendante significative entre la plombémie et le seuil d’audition pour des fréquences allant de 0,5 à 4 kHz a été constatée, et ce, après l’élimination de plusieurs facteurs de confusion. L’effet du plomb se manifestait quelle que soit l’intensité de l’exposition et pouvait être décelé à des plombémies inférieures à 10 µg/100 ml. Chez les enfants ne présentant pas de signes cliniques d’intoxication saturnine, une relation linéaire a été mise en évidence entre la plombémie et les latences des ondes III et V des potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral, ce qui indique un site d’action central par rapport au noyau cochléaire (Otto et coll., 1985).
L’hypoacousie est fréquemment décrite dans le tableau clinique de l’intoxication aiguë ou chronique par le méthylmercure. On a mis en cause des lésions à la fois cochléaires et rétrocochléaires (Oyanagi et coll., 1989). Le mercure inorganique peut également affecter l’appareil auditif, probablement en lésant les structures cochléaires.
L’exposition à l’arsenic minéral a été mise en cause dans les troubles auditifs des enfants. Une hypoacousie sévère (30 dB) a été très fréquemment constatée chez des enfants nourris avec du lait en poudre contaminé par de l’arsenic minéral pentavalent. Une étude tchécoslovaque a constaté, chez des enfants de 10 ans, une hypoacousie confirmée par audiométrie, résultant d’une exposition environnementale à de l’arsenic provenant d’une centrale alimentée au charbon. Les composants non organiques de l’arsenic ont provoqué d’importantes lésions cochléaires chez les animaux d’expérience (OMS, 1983).
Dans l’intoxication aiguë par le triméthylétain, les symptômes précoces ont été une hypoacousie et des acouphènes. Lors de la consultation, l’audiométrie a révélé une atteinte auditive intéressant toute la cochlée, comprise entre 15 et 30 dB. On ne sait pas de façon claire si ces troubles ont été réversibles (Besser et coll., 1987). Chez l’animal, le triméthylétain et le triéthylétain ont provoqué des lésions cochléaires partiellement réversibles (Clerisi et coll.,1991).
Produits asphyxiants. Chez l’humain, dans l’intoxication aiguë par le monoxyde de carbone ou le sulfure d’hydrogène, on a souvent constaté des troubles auditifs associés à une atteinte du système nerveux central (Rybak, 1992).
Lors d’essais chez les rongeurs, on a constaté une synergie entre l’exposition au monoxyde de carbone et le bruit sur les seuils d’audition et les structures cochléaires. On n’a constaté aucun effet après exposition au seul monoxyde de carbone (Fechter et coll., 1988).
Les études expérimentales ont confirmé que plusieurs solvants peuvent provoquer des troubles de l’audition dans certaines conditions d’exposition. Les études faites chez l’humain ont indiqué qu’un tel effet peut se produire à la suite d’expositions qui sont courantes en milieu de travail. Des études chez l’humain et les animaux d’expérience ont montré des effets synergiques du bruit et des produits chimiques. Certains métaux lourds peuvent agir sur l’audition, pour la plupart d’entre eux seulement à des niveaux d’exposition provoquant une toxicité systémique patente. Dans le cas du plomb, des effets mineurs ont été observés sur le seuil d’audition pour des expositions très inférieures aux expositions professionnelles. On n’a pas confirmé à ce jour d’effet ototoxique spécifique des produits asphyxiants, bien que le mon- oxyde de carbone puisse augmenter les effets du bruit sur l’audition.
L’appareil auditif, du fait de sa position à l’intérieur du crâne, est généralement bien protégé contre les traumatismes. Il peut, toutefois, être affecté par divers risques physiques en relation avec le travail dont les suivants:
Barotraumatismes. Les variations soudaines de la pression barométrique (par montée ou descente rapide en plongée ou par descente soudaine en avion) associées à un dysfonctionnement de la trompe d’Eustache (ne permettant pas l’équilibrage des pressions) peuvent provoquer une rupture de la membrane tympanique, avec douleur et hémorragie au niveau de l’oreille moyenne et externe. Dans les cas moins graves, l’étirement de la membrane tympanique cause une douleur plus ou moins intense. Il se produit une hypoacousie passagère (de transmission), mais le traumatisme a généralement une évolution favorable et la récupération fonctionnelle est totale.
Vibrations. L’exposition simultanée à des vibrations et au bruit (continu ou impulsif) n’augmente pas le risque ou la sévérité de l’hypoacousie neurosensorielle due au bruit; cependant, la fréquence des troubles semble être augmentée chez les travailleurs présentant un syndrome de vibrations du système main-bras (maladie des outils vibrants). On suppose que la circulation cochléaire est affectée par un spasme sympathique réflexe quand les travailleurs concernés présentent une vasoconstriction (phénomène de Raynaud) au niveau des doigts ou des orteils.
Infra- et ultrasons. Ils sont normalement imperceptibles à l’oreille humaine. Les sources courantes d’ultrasons, comme les moteurs à réaction, les fraises dentaires à grande turbine, les nettoyeurs à ultrasons et les mixers, émettent toutes des sons audibles; il est donc difficile de discerner l’effet propre des ultrasons sur les sujets exposés. On suppose que les ultrasons sont inoffensifs au-dessous de 120 dB et qu’ils ne provoquent probablement pas de déficit auditif. De même, les bruits de très basse fréquence sont relativement sans danger à faible intensité, alors qu’à forte intensité (119-144 dB) on peut observer une hypoacousie.
«Oreille du soudeur». Des étincelles brûlantes peuvent pénétrer dans le conduit auditif externe, atteindre et brûler la membrane tympanique. Il en résulte une douleur aiguë accompagnée, parfois, d’une paralysie faciale. Les brûlures légères n’exigent pas de traitement, mais dans les cas plus graves une réparation chirurgicale de la membrane tympanique peut s’avérer nécessaire. On peut prévenir ce risque en portant correctement son masque de soudure ainsi que des bouchons d’oreilles.
La perception, le contrôle de l’orientation et des mouvements du corps dans l’espace sont réalisés par un système mettant en jeu simultanément des informations ayant une triple origine: les yeux, l’appareil vestibulaire de l’oreille interne et les capteurs musculaires, articulaires et cutanés, qui fournissent les informations somato-sensorielles ou «proprioceptives» relatives aux mouvements du corps et à sa relation physique avec l’environnement (voir figure 11.5). L’ensemble de ces informations sont intégrées dans le système nerveux central qui déclenche les actions appropriées pour rétablir et maintenir l’équilibre, la coordination et le bien-être. Toute défaillance d’un élément de ce système peut entraîner un malaise, un état vertigineux ou une instabilité susceptibles de provoquer divers troubles ou une chute.
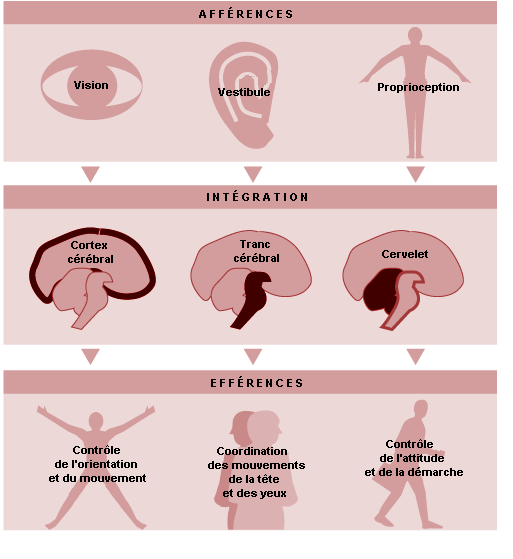
L’appareil vestibulaire enregistre directement l’orientation et les mouvements de la tête. Le labyrinthe vestibulaire est une petite structure osseuse de l’oreille interne, comprenant les canaux semi-circulaires remplis d’un liquide (l’endolymphe) et les otolithes (voir figure 11.6). Les trois canaux semi-circulaires sont perpendiculaires entre eux, ce qui leur permet de détecter les accélérations dans chacun des trois plans d’un mouvement angulaire. Quand la tête tourne, le mouvement relatif (dû à l’inertie) de l’endolymphe à l’intérieur des canaux déplace les cils bordant les cellules sensorielles et induit un signal nerveux (voir figure 11.7). Les otolithes contiennent des cristaux lourds (otoconies) qui répondent aux changements de position de la tête par rapport à la pesanteur et aux accélérations ou décélérations linéaires, en déformant eux aussi les cils, ce qui modifie le signal nerveux provenant des cellules sensorielles auxquelles les cils et les otolithes sont fixés.
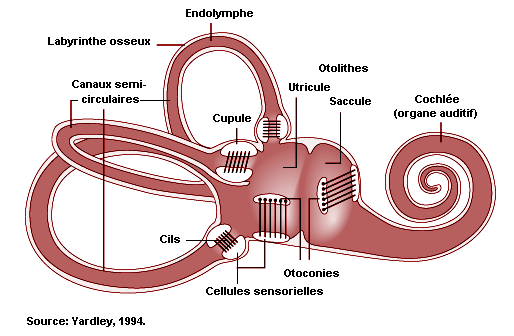
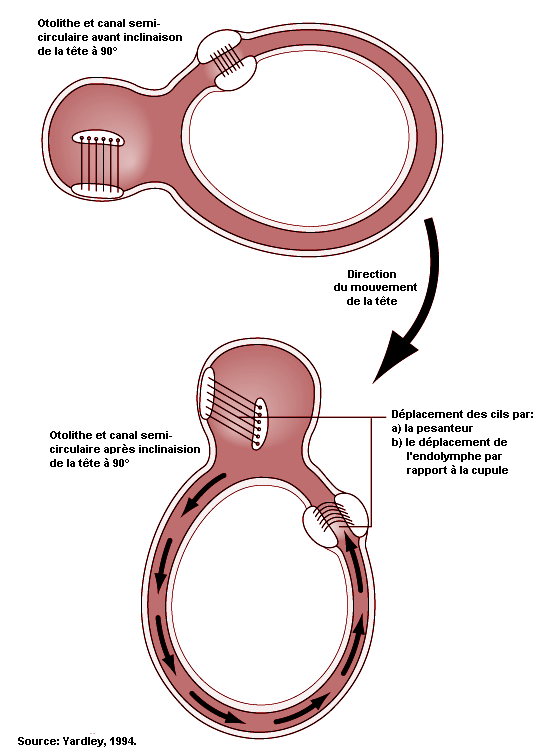
Les connexions centrales du système d’équilibration sont extrêmement complexes; les informations fournies par l’appareil vestibulaire des deux oreilles sont combinées avec celles fournies par la vision et le système somato-sensoriel à différents niveaux du tronc cérébral, du cervelet et du cortex cérébral (Luxon, 1984).
Ces informations intégrées sont à la base non seulement de la perception consciente de l’orientation et du mouvement volontaire, mais aussi du contrôle automatique des mouvements des yeux et de la posture par la voie des réflexes dits vestibulo-oculaires et vestibulo-spinaux. Le réflexe vestibulo-oculaire a pour fonction de maintenir les yeux fixés de façon stable sur un point pendant les déplacements de la tête en compensant automa- tiquement ceux-ci par un déplacement équivalent des yeux en direction opposée (Howard, 1982). Les réflexes vestibulo-spinaux contribuent à la stabilité de la posture et à l’équilibre (Pompeiano et Allum, 1988).
A l’état normal, les informations vestibulaires, visuelles et somato-sensorielles concordent, mais en cas de discordance apparente entre les différentes informations sensorielles fournies au système de l’équilibre, il se produit une sensation de vertige et de désorientation ou une illusion de mouvement. Si la sensation vertigineuse se prolonge ou si elle est importante, elle s’accompagne de manifestations secondaires, telles que nausées, sueurs froides, pâleur, fatigue ou même vomissements. Une perturbation du contrôle réflexe des mouvements oculaires et de la posture peut entraîner une vision floue ou instable, une tendance à dévier latéralement lors de la marche, ou une instabilité et la chute. Le terme médical désignant la désorientation due à un dysfonctionnement de l’appareil de l’équilibre est «vertige»; celui-ci peut être provoqué par une atteinte de n’importe lequel des systèmes sensoriels contribuant à l’équilibre ou par un trouble de l’intégration centrale. Chaque année, seuls 1 à 2% de la population consultent un médecin pour des vertiges, mais l’incidence de la sensation de vertige et de déséquilibre augmente fortement avec l’âge. Le «mal des transports» est une forme de désorientation provoquée par des conditions environnementales artificielles, telles que transport passif en voiture ou en bateau, à la maîtrise desquelles notre système d’équilibration n’a pas été adapté au cours de l’évolution (Crampton, 1990).
Les causes les plus fréquentes de troubles vestibulaires sont l’infection (labyrinthite vestibulaire) et le vertige paroxystique positionnel bénin, déclenché principalement par le décubitus latéral. Des crises récurrentes de vertige sévère, accompagnées d’hypoacousie et d’acouphènes dans une oreille, sont typiques d’un syndrome connu sous le nom de maladie de Ménière. Les lésions vestibulaires peuvent également être dues à des affections de l’oreille moyenne (dont les infections bactériennes, les traumatismes et les choléstéatomes), à des médicaments otoxiques (qui ne devraient être utilisés que dans les cas médicalement justifiés) et à des traumatismes crâniens.
De nombreux cliniciens pensent que les atteintes osseuses de la colonne cervicale peuvent être une cause de vertige en modifiant les informations somato-sensorielles relatives aux mouvements de la tête ou en gênant l’irrigation sanguine de l’appareil vestibulaire. Les étiologies courantes sont les lésions du «coup du lapin» et les arthropathies. Le manque d’équilibre peut être dû parfois à une perte de sensibilité des pieds et des jambes associée au diabète, à l’alcoolisme, à des carences vitaminiques, à des lésions médullaires ou à diverses autres affections. Dans certains cas, l’origine de sensations vertigineuses ou de l’illusion de mouvement de l’environnement peut être mise en relation avec des déformations visuelles. Une telle altération des informations visuelles peut être due à une faiblesse des muscles oculaires ou se produire au cours de l’adaptation à des verres de lunette puissants ou à double foyer.
La plupart des cas de vertiges peuvent être attribués à des troubles périphériques (surtout vestibulaires), mais des lésions du tronc cérébral, du cervelet et du cortex cérébral peuvent aussi être responsables de manifestations de désorientation. Les vertiges d’origine centrale s’accompagnent presque toujours d’autres signes nerveux centraux, tels que douleurs, fourmillements ou engourdissements de la face ou des membres, difficultés de la parole (dysarthrie) et difficultés à avaler (dysphagie), céphalées, troubles visuels et perte du contrôle de la motricité ou perte de connaissance. Les causes centrales les plus fréquentes de ces vertiges sont les troubles de l’irrigation sanguine du cerveau (allant de la migraine à l’accident vasculaire cérébral), l’épilepsie, la sclérose en plaques, l’alcoolisme et parfois les tumeurs. Des sensations vertigineuses et un déséquilibre passager peuvent être un effet secondaire d’une grande variété de médicaments, dont certains analgésiques d’usage courant, certains contraceptifs ou médicaments utilisés dans le traitement des affections cardio-vasculaires, du diabète, de la maladie de Parkinson et, en particulier, des médicaments à action centrale, tels que certains stimulants, sédatifs, anticonvulsivants, antidépresseurs et tranquillisants (Ballantyne et Ajodhia, 1984).
Tous les cas de vertiges nécessitent un avis médical pour s’assurer que les affections graves (relativement rares) pouvant en être la cause soient identifiées et traitées. A court terme, des médicaments peuvent être administrés pour supprimer les symptômes de vertige aigu et une intervention chirurgicale sera proposée dans de rares cas. Dans les vertiges d’origine vestibulaire, les symptômes disparaissent généralement avec le temps, car les centres d’intégration s’adaptent aux informations vestibulaires anormales — à la façon dont les marins constamment exposés aux mouvements de leur navire acquièrent le «pied marin». Pour ce faire, il est essentiel que le malade continue à avoir une grande activité pour stimuler son système de l’équilibre, même si cela provoque d’abord un malaise et des sensations vertigineuses. Les symptômes de vertiges étant inquiétants et gênants, ces malades peuvent avoir besoin d’une rééducation et d’un soutien psychologique pour lutter contre leur tendance naturelle à réduire leur activité (Beyts, 1987; Yardley, 1994).
Chez les travailleurs exposés aux solvants organiques, des sensations vertigineuses et une désorientation pouvant devenir chroniques sont des symptômes fréquents; de plus, une exposition prolongée peut faire apparaître des signes objectifs de dysfonctionnement du système de l’équilibre (par exemple, des réflexes vestibulo-oculaires anormaux), même chez des personnes n’éprouvant pas de sensation subjective de vertiges (Gyntelberg et coll., 1986; Möller et coll., 1990). Les barotraumatismes subis en avion ou lors de plongées peuvent léser les organes vestibulaires et provoquer une hypoacousie et un vertige brusques nécessitant un traitement immédiat (Head, 1984). D’après certaines constatations, l’hypoacousie provoquée par un bruit peut s’accompagner de lésions de l’appareil vestibulaire (van Dijk, 1986). Les personnes travaillant pendant de longues périodes devant un écran d’ordinateur se plaignent parfois de sensations vertigineuses; la cause en reste mal connue, mais elle peut être la combinaison d’une contracture de la nuque et de stimulations visuelles mobiles.
Des crises inattendues de vertiges, telles que celles survenant dans la maladie de Ménière, peuvent se révéler dangereuses pour les personnes travaillant en hauteur, conduisant des véhicules, utilisant des engins dangereux ou responsables de la sécurité d’autres personnes. Une sensibilité accrue au mal des transports est un effet fréquent des dysfonctionnements du système d’équilibration et peut être gênante pour les personnes devant voyager.
L’équilibre est assuré par un système multisensoriel complexe; la désorientation spatiale et le manque d’équilibre peuvent avoir des étiologies très variées et résulter en particulier d’affections du système vestibulaire ou du système central d’intégration des informations contribuant à l’orientation spatiale. En l’absence de lésions nerveuses centrales, la plasticité du système d’équilibration permet normalement une adaptation aux causes périphériques de désorientation, qu’il s’agisse de troubles de l’oreille interne affectant le vestibule ou de facteurs environnementaux provoquant le mal des transports. Les crises vertigineuses sont cependant souvent imprévisibles, alarmantes et invalidantes, et une rééducation peut s’avérer nécessaire pour rétablir la confiance du malade et ses fonctions d’équilibration.
L’œil est une sphère (Graham et coll., 1965; Adler, 1992) d’environ 20 mm de diamètre, placée dans l’orbite, qui est mue par six muscles (oculaires) attachés à la sclérotique, sa paroi externe (voir figure 11.8). En avant, la sclérotique est remplacée par la cornée qui est transparente. Derrière la cornée, dans la chambre antérieure, se trouve l’iris qui règle le diamètre pupillaire, orifice traversé par l’axe optique. Le fond de la chambre antérieure est formé par une lentille biconvexe appelée cristallin, dont la courbure est déterminée par la contraction des muscles ciliaires; ceux-ci sont fixés en avant à la sclérotique et en arrière à la membrane choroïde qui borde la chambre postérieure. Cette dernière est remplie par l’humeur vitreuse — liquide clair et gélatineux. La choroïde, surface interne de la chambre postérieure, est noire afin de prévenir les réflexions lumineuses parasites qui pourraient gêner l’acuité visuelle.
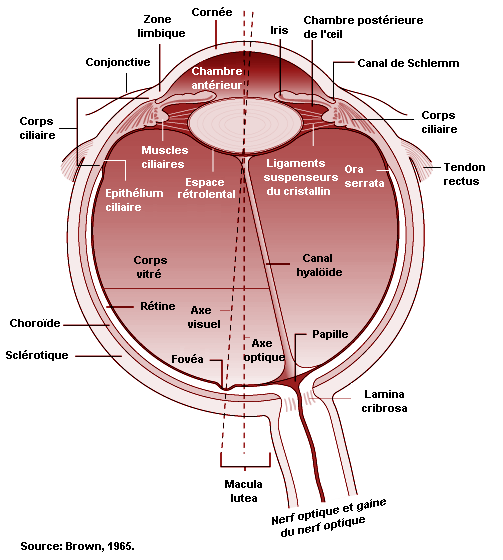
Les paupières contribuent à maintenir le film lacrymal produit par les glandes lacrymales et qui protège la surface antérieure de l’œil. Le clignement favorise la dispersion des larmes et leur évacuation vers le canal lacrymal qui se vide dans la cavité nasale. La fréquence du clignement varie beaucoup, en particulier en fonction de l’activité et de l’environnement lumineux; c’est pourquoi on l’utilise comme test en ergonomie. Ainsi, cette fréquence se ralentit lors de la lecture et quand la lumière est plus intense.
Il existe deux muscles dans la chambre antérieure: le sphincter de l’iris qui contracte la pupille et le muscle dilatateur de la pupille qui l’élargit. Si un faisceau de lumière est dirigé vers un œil normal, la pupille se contracte (réflexe pupillaire); il en va de même quand le regard se dirige vers un objet proche.
La rétine possède plusieurs couches internes de cellules nerveuses et une couche externe contenant deux types de photorécepteurs: les bâtonnets et les cônes. Ainsi, la lumière atteint les cônes et les bâtonnets en traversant la couche de cellules nerveuses et, selon un mécanisme non encore entièrement élucidé, génère des impulsions dans les cellules nerveuses qui, transportées le long des fibres optiques, atteindront le cerveau. Les cônes, au nombre de 4 à 5 millions, sont responsables de la vision nette et de la vision colorée; ils sont très denses au centre de la rétine, en particulier dans la fovéa qui constitue une petite dépression exempte de bâtonnets et où l’acuité visuelle est la meilleure. A l’aide de la spectrophotométrie, on a identifié trois types de cônes dont les pigments présentent un pic d’absorption soit dans le jaune, soit dans le vert, soit dans le bleu et qui rendent compte de la capacité de distinguer la couleur. Les bâtonnets, au nombre de 80 à 100 millions, sont responsables de la vision nocturne et deviennent de plus en plus nombreux vers la périphérie de la rétine. Ils jouent aussi un rôle déterminant dans la vision noir et blanc, de même que dans la perception du mouvement.
Les fibres nerveuses, accompagnées des vaisseaux sanguins qui alimentent la rétine, traversent la choroïde, la couche moyenne des trois couches constituant la paroi de la chambre postérieure, et quittent l’œil en formant le nerf optique en une région légèrement excentrée qui, dépourvue de photorécepteurs, est connue sous le nom de tache aveugle.
Les vaisseaux rétiniens, les seules artères ou veines directement visibles, peuvent être observés avec un ophtalmoscope qui permet de faire pénétrer un faisceau lumineux à travers la pupille. Les images ainsi focalisées peuvent aussi être photographiées. Cet examen rétinoscopique, qui fait partie de l’examen médical de routine, permet d’apprécier la détérioration des vaisseaux, dans des maladies telles que l’artériosclérose, le diabète et l’hypertension pouvant entraîner des hémorragies et des exsudations dans la rétine et conduire à des altérations du champ visuel.
Dans l’œil emmétrope (normal) au repos, les rayons lumineux qui traversent la cornée, la pupille et le cristallin convergent sur la rétine, produisant une image inversée qui se retourne dans les centres de la vision.
Quand l’œil regarde un objet lointain, le cristallin est aplati. S’il regarde un objet proche, le cristallin accommode — c’est-à-dire augmente sa puissance — grâce à la contraction des muscles ciliaires et acquiert, du fait de son élasticité, une forme plus bombée. La contraction pupillaire qui se produit simultanément améliore la qualité de l’image en réduisant les aberrations sphériques et chromatiques du système dioptrique et en augmentant la profondeur de champ.
Dans la vision binoculaire, l’accommodation s’accompagne nécessairement d’une convergence proportionnelle des deux yeux.
Le champ visuel (espace couvert par les deux yeux au repos) est limité par des obstacles anatomiques dans le sens horizontal (plus restreint du côté du nez) et dans le plan vertical (réduit par les rebords supérieurs de l’orbite). En vision binoculaire, le champ horizontal est d’environ 180 degrés et le champ vertical de 120 à 130 degrés. En vision photopique (vision de jour), la plupart des fonctions visuelles s’affaiblissent dans la périphérie du champ visuel; la perception du mouvement, au contraire, s’améliore. En vision mésopique (vision nocturne), il y a une perte considérable d’acuité dans le centre du champ visuel où, comme on l’a vu, les bâtonnets sont moins nombreux.
Le champ du regard s’étend au-delà du champ visuel grâce à la mobilisation des yeux, de la tête et du corps; dans l’activité professionnelle, c’est le champ du regard qui compte surtout.
Les causes de réduction du champ visuel, qu’elles soient anatomiques ou physiologiques, sont multiples: rétrécissement pupillaire, opacité du cristallin, lésions pathologiques de la rétine, des voies ou des centres visuels; faible luminance de l’objet à percevoir; montures de lunettes de correction ou de protection, mouvement ou vitesse de l’objet à percevoir et d’autres encore.
«L’acuité visuelle (AV) est l’aptitude à distinguer les détails fins d’un objet situé dans le champ de vision. Elle se définit par la dimension minimum de quelques aspects caractéristiques de l’objet que le sujet est capable d’identifier correctement» (Riggs, 1965). Une acuité visuelle élevée est la capacité de percevoir des petits détails. L’acuité visuelle définit la limite de discrimination spatiale accessible à l’œil.
La dimension rétinienne d’un objet dépend non seulement de sa dimension physique, mais aussi de sa distance à l’œil; c’est pourquoi on l’exprime en angle visuel (habituellement en minutes d’arc). L’acuité visuelle est la réciproque de cet angle.
Riggs (1965) décrit plusieurs sortes de mesures d’acuité. En pratique clinique et en médecine du travail, la tâche de reconnaissance, dans laquelle le sujet est prié de désigner l’objet-test et d’en situer certains détails, est la plus communément appliquée. Par commodité, l’acuité visuelle se mesure en ophtalmologie, relativement à une valeur dite «normale», sur des optotypes qui présentent des séries d’objets de dimensions différentes; ceux-ci doivent être vus à une distance standard.
En clinique, les tables de Snellen sont très largement utilisées pour déterminer l’acuité de loin; la dimension et la forme générale des objets sont conçues de manière à sous-tendre un angle de 1 mn à la distance standard qui varie de pays en pays (20 pieds entre l’optotype et l’œil aux Etats-Unis, 6 m dans la plupart des pays européens). Avec la table de Snellen, l’acuité maximale est donc de 20/20. Les optotypes contiennent également des objets plus grands, formant des angles de 1 mn pour des distances supérieures.
L’acuité visuelle d’un individu se calcule par la relation AV = D’/D, où D’ est la distance de vision standard et D la distance à laquelle le plus petit objet correctement identifié par le sujet sous-tend un angle de 1 mn d’arc. Par exemple, l’acuité d’une personne est de 20/30 si, à une distance de vision de 20 pieds, cette personne peut seulement identifier un objet qui sous-tend un angle de 1 mn d’arc à 30 pieds.
Dans la pratique optométrique, les objets sont souvent des lettres ou des formes familières (pour les enfants ou pour les illettrés). Néanmoins, quand l’examen doit être répété, comme en psychophysique, il est préférable que les optotypes portent des caractères dont on ne peut pas se souvenir et qui ne sont associés à aucune valeur culturelle et ne dépendent pas du niveau d’instruction. C’est pour cette raison que l’usage des anneaux de Landolt est recommandé au niveau international, du moins pour les expériences scientifiques. Les anneaux de Landolt sont des cercles portant une brisure dont l’orientation doit être perçue et identifiée par le sujet.
Sauf chez les personnes âgées ou les porteurs de défauts de l’accommodation, l’acuité visuelle de loin et l’acuité visuelle de près évoluent parallèlement. La plupart des activités professionnelles réclament à la fois une bonne vision de loin (sans accommodation) et une bonne vision de près. Des tables de Snellen existent aussi pour la vision de près (voir figures 11.9 et 11.10). La table présentée à la figure 11.10 devrait être placée à 16 pouces (40 cm) de l’œil; en Europe, des tables semblables existent pour la distance de 30 cm (la distance appropriée pour lire le journal).
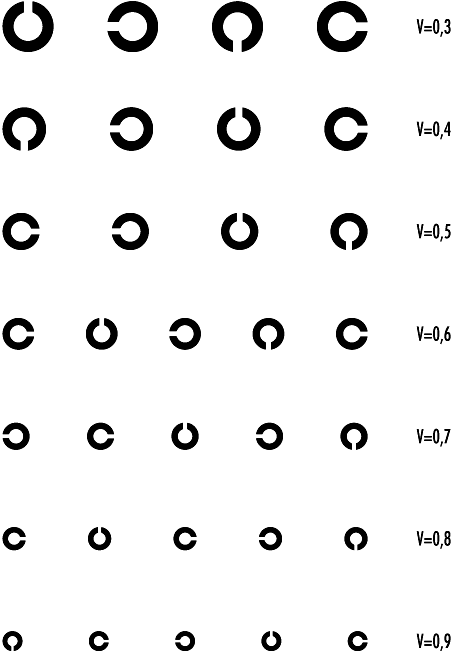
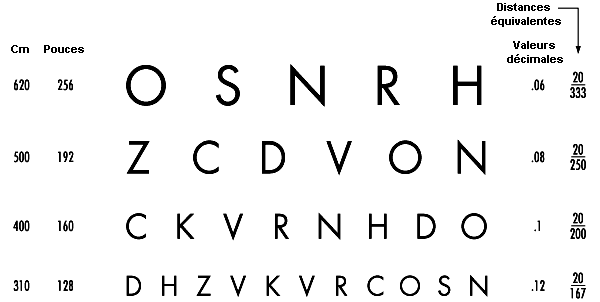

Cependant, avec l’extension du travail informatisé, on s’intéresse de plus en plus à l’examen des opérateurs à une distance intermédiaire plus grande (60 à 70 cm d’après Krueger, 1992), afin de corriger convenablement les opérateurs sur écran.
Pour le dépistage visuel en milieu de travail, on trouve sur le marché différents types d’appareils ayant beaucoup de choses en commun: on les nomme Orthorater, Visiotest, Ergovision, Titmus Optical C Vision Tester, C45 Glare Tester, Mesoptometer, Nyctometer, etc.
Ces appareils sont de petite taille; leur éclairage est indépendant de celui de la salle d’examen; ils offrent plusieurs tests visuels: non seulement l’acuité visuelle mono- et binoculaire en vision de près ou de loin (le plus souvent avec des optotypes non mémorisables), mais aussi la perception de la profondeur ou du relief, une rapide discrimination des couleurs, l’équilibre des axes du regard, etc. L’acuité visuelle de près peut être déterminée, pour certains d’entre eux, à distance courte et intermédiaire. Le plus récent de ces instruments fait appel à l’électronique pour fournir automa- tiquement le résultat imprimé de différents tests. Tous ces appareils peuvent être manipulés par du personnel non qualifié, après un simple apprentissage.
Ces appareils sont conçus pour le dépistage d’embauche, de même que pour l’examen périodique durant lequel on tient compte des exigences visuelles du poste de travail. On trouvera au tableau 11.2 les niveaux d’acuité moyens requis pour remplir des tâches non qualifiées jusqu’à très qualifiées, correspondant à l’utilisation d’un appareil de dépistage particulier (Fox, 1973).
|
Classe I: travail de bureau et administration |
|
Acuité visuelle de loin: 20/30 à chaque œil et 20/25 en vision binoculaire |
|
Acuité visuelle de près: 20/25 à chaque œil et 20/20 en vision binoculaire |
|
Classe II: travaux d’inspection |
|
Acuité visuelle de loin: 20/35 à chaque œil et 20/30 en vision binoculaire |
|
Acuité visuelle de près: 20/25 à chaque œil et 20/20 en vision binoculaire |
|
Classe III: opérateurs d’engins mobiles |
|
Acuité visuelle de loin: 20/25 à chaque œil et 20/20 en vision binoculaire |
|
Acuité visuelle de près: 20/35 à chaque œil et 20/30 en vision binoculaire |
|
Classe IV: travaux à la machine |
|
Acuité visuelle de loin et de près: 20/30 à chaque œil et 20/25 en vision binoculaire |
|
Classe V: manœuvres |
|
Acuité visuelle de loin: 20/30 à chaque œil et 20/25 en vision binoculaire |
|
Acuité visuelle de près: 20/35 à chaque œil et 20/30 en vision binoculaire |
|
Classe VI: mécaniciens et personnel de maîtrise |
|
Acuité visuelle de loin: 20/30 à chaque œil et 20/25 en vision binoculaire |
|
Acuité visuelle de près: 20/25 à chaque œil et 20/20 en vision binoculaire |
Source: Fox, 1973.
Les fabricants recommandent que les salariés soient examinés avec les lunettes qu’ils portent au travail. Fox (1973) souligne cependant que cette pratique peut aboutir à des résultats erronés. Ainsi, il peut arriver que les travailleurs portent, au moment du test, des lunettes qui ne correspondent plus à leur vue ou encore que leurs verres soient usés par l’exposition aux poussières ou à d’autres produits corrosifs. Parfois, les salariés se présentent à la salle d’examen avec les mauvaises lunettes. C’est pourquoi Fox (1973) préconise que, si la vision corrigée n’atteint pas 20/20 pour l’acuité de loin et de près, le salarié doit retourner chez un oculiste pour un examen approfondi et une réfractométrie. D’autres limites de ces appareils seront traitées plus loin dans le présent article.
L’acuité visuelle trouve sa première limite dans la structure de la «mosaïque rétinienne». En vision diurne, elle peut dépasser 10/10 dans la fovéa et décroître rapidement quand on s’éloigne de quelques degrés du centre de la rétine; en vision nocturne, l’acuité très faible à nulle au centre peut atteindre 1/10 à la périphérie, du fait de la distribution des cônes et des bâtonnets qui a été décrite antérieurement (figure 11.11).
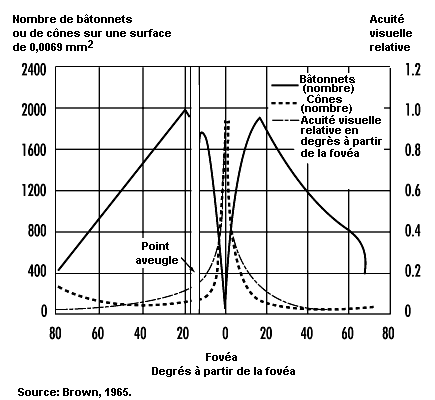
Le diamètre pupillaire agit de manière complexe sur la performance visuelle. Quand elle est dilatée, la pupille laisse passer davantage de lumière dans l’œil, ce qui stimule la rétine; le flou dû à la diffraction de la lumière est réduit. Une pupille rétrécie, si elle a pour effet une réduction de l’éclairement rétinien, en diminuant les aberrations sphériques et chromatiques du cristallin, favorise néanmoins la vision nette.
Grâce au processus de l’adaptation, il est possible à l’être humain de voir aussi bien au clair de lune qu’en pleine lumière du soleil, alors même que le rapport des éclairements varie de 1 à 10 000 000. La sensibilité visuelle est si étendue que l’on a pris l’habitude de placer les intensités lumineuses sur une échelle logarithmique.
En entrant dans une chambre noire, on est d’abord totalement aveugle, puis les objets autour de soi deviennent perceptibles. A mesure que la lumière augmente, on assiste au passage de la vision dominée par les bâtonnets à la vision dominée par les cônes. Le changement de sensibilité spectrale qui accompagne ce phénomène s’appelle l’effet Purkinje. La rétine adaptée à l’obscurité est surtout sensible aux basses luminances, mais se caractérise par l’absence de vision colorée et par une faiblesse de la résolution spatiale (acuité visuelle basse); la rétine adaptée à la lumière est peu sensible aux basses luminances (il faut que les objets soient bien illuminés pour être perçus), mais se caractérise par un pouvoir de séparation spatiale et temporelle élevé et par la vision colorée. Après diminution de sa sensibilité provoquée par une stimulation lumineuse intense, l’œil récupère cette sensibilité selon une progression caractéristique: on observe une phase rapide qui concerne les cônes et l’adaptation photopique, suivie d’une phase lente qui concerne les bâtonnets et l’adaptation scotopique; la zone intermédiaire concerne la vision mésopique.
Dans le milieu de travail, l’adaptation scotopique n’intéresse guère que des activités en chambre noire (comme dans la lecture des films en physique nucléaire ou la photographie en général) et la conduite nocturne (encore que la réflexion de la lumière des phares sur la route suffise à assurer une certaine luminance). Il est évident que la majorité des activités industrielles ou de bureau s’effectuent, sous éclairement naturel ou artificiel, dans des conditions diurnes correspondant à l’adaptation photopique. Néanmoins, avec l’arrivée des écrans d’ordinateur, on se trouve souvent aujourd’hui dans des conditions de faible luminance qui correspondent à l’adaptation intermédiaire mésopique.
En médecine du travail, le comportement de groupes de personnes s’impose (par comparaison aux particularités individuelles) quand il s’agit de choisir l’aménagement le plus approprié des postes de travail. Les résultats obtenus à Genève par Meyer et ses collaborateurs en 1990, dans une étude portant sur 780 employés de bureau, montrent les changements de distribution des acuités visuelles avec la luminance. On s’aperçoit que, adaptés à la lumière du jour, la plupart des travailleurs examinés avec leur correction oculaire peuvent atteindre une acuité visuelle très élevée; aussitôt que la lumière environnante diminue, l’acuité visuelle moyenne diminue mais, en même temps, les valeurs se dispersent, tirées vers le bas par un certain nombre d’individus; cette tendance s’accentue quand une source éblouissante vient s’additionner à cette ambiance lumineuse faible (voir figure 11.12). En d’autres termes, il est très difficile de prédire quelle performance un sujet présentera dans des conditions de faible éclairage, en ne mesurant son acuité que dans des conditions photopiques optimales.
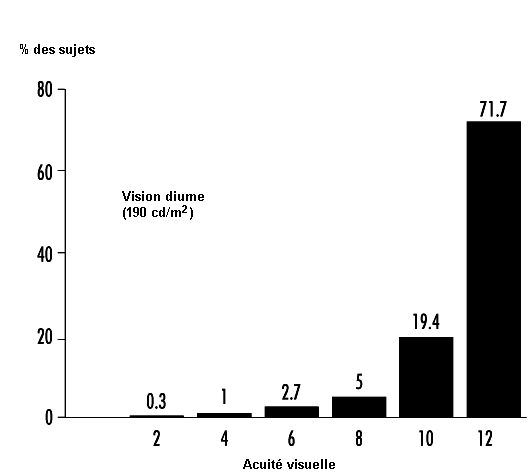

L’éblouissement. Si le regard se déplace d’une zone sombre vers une zone claire ou vice versa, ou si le sujet fixe momentanément un luminaire ou une fenêtre (avec des luminances variant entre 1 000 et 12 000 cd/m2), le changement d’adaptation ne concerne qu’une région limitée du champ visuel (adaptation locale). Le temps de récupération, après éblouissement perturbateur, peut alors atteindre plusieurs secondes, suivant l’éclairement et le contraste de l’objet à percevoir (Meyer et coll., 1986) (voir figure 11.13).
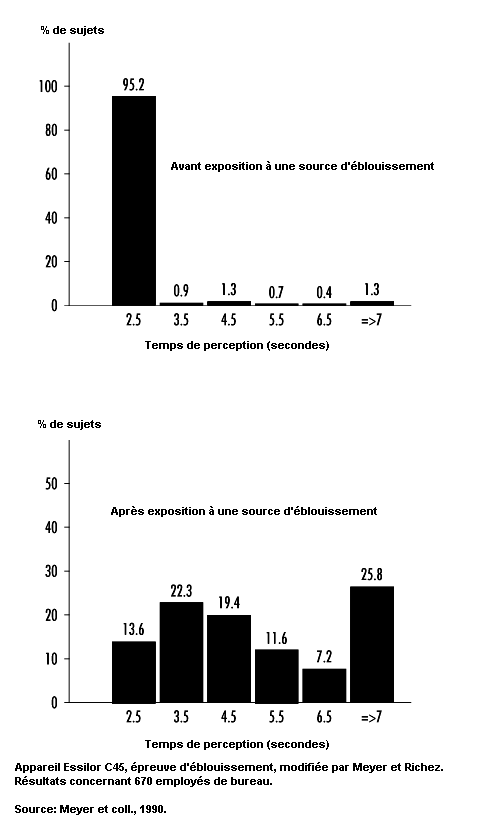
Les images consécutives. La désadaptation locale s’accompagne habituellement de la vision persistante d’une tache lumineuse, colorée ou non, qui produit un effet de voile ou de masque (c’est l’image consécutive). Les images consécutives ont été étudiées de manière approfondie pour mieux saisir certains phénomènes visuels (Brown, 1965). Quand la stimulation visuelle a cessé, l’effet subsiste un certain temps; cette persistance explique, par exemple, pourquoi on peut percevoir une lumière continue, alors même que l’on regarde une lumière intermittente (voir plus loin) dont la fréquence est suffisamment élevée. De même, lorsqu’on regarde la nuit une file d’automobiles, l’œil peut percevoir une ligne lumineuse. Ces images consécutives se produisent dans l’obscurité quand la vue se porte sur un point lumineux; elles se produisent aussi en présence de surfaces colorées, laissant une sensation de couleur qui peut être gênante. C’est pour cette raison que des opérateurs peuvent être exposés à des images colorées persistantes après avoir travaillé, durant longtemps, devant leur écran et tourné le regard vers une autre surface de leur bureau.
Les images consécutives sont très compliquées. Par exemple, dans une expérience, on a constaté qu’une tache bleue apparaissait blanche durant les premières secondes d’observation, puis rose après trente secondes, et rouge vif après une minute ou deux. Dans une autre expérience, un champ rouge orangé apparaissait momentanément rose, puis, dans les dix à quinze secondes suivantes, tournait de l’orange au jaune pour prendre un aspect vert brillant qui persistait durant toute la fin de l’observation. Quand le point de fixation se déplace, l’image consécutive se déplace aussi (Brown, dans Graham et coll., 1965). Ces effets sont très désagréables pour les opérateurs sur écran.
La lumière diffuse émise par des sources éblouissantes a pour conséquence de diminuer le contraste objet-fond (effet de voile) et d’abaisser l’acuité. On parle alors d’éblouissement perturbant.
Les ergophtalmologistes décrivent aussi l’éblouissement inconfortable qui ne réduit pas l’acuité visuelle, mais qui occasionne une sensation pénible, voire douloureuse (IESNA, 1993).
Au poste de travail, le niveau d’éclairement doit être choisi en fonction des exigences de la tâche. Si, dans un environnement lumineux stable, il suffit de percevoir des formes, on peut se contenter d’un éclairement faible; mais dès qu’il s’agit de voir des détails fins qui nécessitent une acuité visuelle élevée, ou si le travail implique la discrimination des couleurs, alors l’éclairement rétinien doit être fortement accru.
Le tableau 11.3 indique les valeurs recommandées pour l’éclairage de quelques postes de travail dans différents secteurs d’activité (IESNA, 1993).
|
Industrie du nettoyage des vêtements |
|
|
Nettoyage à sec et à la vapeur |
500-1 000 lux (50-00 candelas) |
|
Inspection et contrôle d’aspect |
2 000-5 000 lux (200-500 candelas) |
|
Réparations et retouches |
1 000-2 000 lux (100-200 candelas) |
|
Industrie des produits laitiers et d’autres matières dérivées du lait |
|
|
Stockage des bouteilles |
200-500 lux (20-50 candelas) |
|
Lavage des bouteilles |
200-500 lux (20-50 candelas) |
|
Remplissage, contrôle |
500-1 000 lux ( 50-100 candelas) |
|
Laboratoires |
500-1 000 lux ( 50-100 candelas) |
|
Equipement électrique |
|
|
Imprégnation |
200-500 lux (20-50 candelas) |
|
Bobinage de solénoïdes |
500-1 000 lux (50-100 candelas) |
|
Centrales électriques |
|
|
Equipement de climatisation |
50-100 lux (50-10 candelas) |
|
Auxiliaires, pompes, réservoirs |
100-200 lux (10-20 candelas) |
|
Industrie du vêtement |
|
|
Inspection, mesures |
10 000-20 000 lux (1 000-2 000 candelas) |
|
Coupe |
2 000-5 000 lux (200-500 candelas) |
|
Repassage |
1 000-2 000 lux (100-200 candelas) |
|
Couture |
2 000-5 000 lux (200-500 candelas) |
|
Empilage, marquage |
500-1 000 lux (50-100 candelas) |
|
Décatissage, bobinage |
200-500 lux (20-50 candelas) |
|
Services bancaires |
|
|
Services généraux |
100-200 lux (10-20 candelas) |
|
Bureaux |
200-500 lux (20-50 candelas) |
|
Guichets |
500-1 000 lux (50-100 candelas) |
|
Elevage laitier |
|
|
Granges |
20-50 lux (2-5 candelas) |
|
Aires de nettoyage |
500-1 000 lux (50-100 candelas) |
|
Secteurs de fourrage |
100-200 lux (10-20 candelas) |
|
Fonderies |
|
|
Fabrication des noyaux — pièces de petite dimension |
1 000-2 000 lux (100-200 candelas) |
|
Fabrication des noyaux — pièces de dimension moyenne |
500-1 000 lux (50-100 candelas) |
|
Modelage — pièces de dimension moyenne |
1 000-2 000 lux (100-200 candelas) |
|
Modelage — pièces de grande dimension |
500-1 000 lux (50-100 candelas) |
|
Contrôle d’aspect — pièces de petite dimension |
1 000-2 000 lux (100-200 candelas) |
|
Contrôle d’aspect — pièces de dimension moyenne |
500-1 000 lux (50-100 candelas) |
Source: IESNA, 1993.
La nature et la distribution spatiale des contrastes au poste de travail. Du point de vue ergonomique, les rapports de luminance entre l’objet et son entourage immédiat et son environnement plus lointain ont été largement étudiés et on dispose de recommandations qui tiennent compte de la difficulté de la tâche visuelle (Verriest et Hermans, 1975; Grandjean, 1987).
Le contraste objet-fond est couramment défini par le rapport Lf-Lo/Lf, où Lf est la luminance du fond et Lo la luminance de l’objet; avec cette formule, le contraste varie de 0 à 1.
Comme l’indique la figure 11.14, l’acuité visuelle augmente (voir plus haut) avec le niveau d’éclairement et aussi avec l’augmentation du contraste objet-fond (Adrian, 1993). Cet effet est particulièrement marqué chez les sujets jeunes. Un large fond clair sur lequel se détache un objet foncé constitue la situation la plus efficace. Malheureusement, dans la réalité, le contraste n’atteint jamais l’unité. Par exemple, quand une lettre noire est imprimée sur une feuille de papier blanche, le contraste objet-fond n’atteint guère plus que 90%.
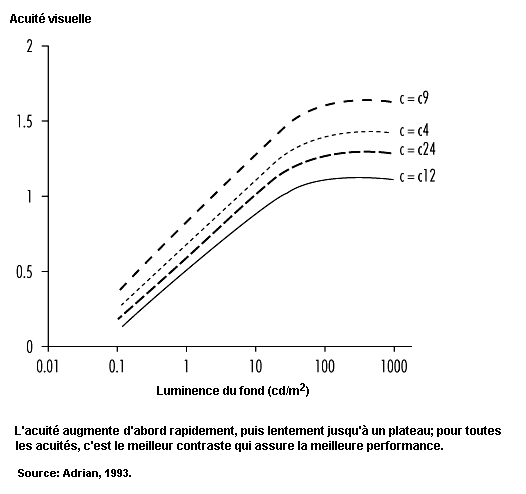
Dans la situation la plus favorable — c’est-à-dire, en présentation positive (lettres foncées sur fond clair) — l’acuité et le contraste sont liés, si bien que la visibilité peut être améliorée en agissant sur l’un ou l’autre facteur (en augmentant, par exemple, la dimension des lettres ou leur noirceur, comme dans la table de Fortuin) (Verriest et Hermans, 1975). Lorsque les écrans cathodiques sont arrivés sur le marché, les lettres ou symboles se présentaient sur l’écran comme des points lumineux sur un fond sombre. Plus tard, des écrans ont été mis au point où les lettres apparaissaient en foncé sur un fond clair. De nombreux essais ont alors été conduits afin de vérifier si cette présentation favorisait la lecture. Aucun doute n’existe quant au fait que l’acuité visuelle est plus élevée en contraste positif; en outre, sur un écran noir, les réflexions parasites en provenance de sources éblouissantes sont plus nombreuses.
Le champ visuel fonctionnel est constitué par l’ensemble des surfaces embrassées par l’œil au poste de travail. On doit notamment se garder de créer des différences de luminosité trop importantes dans le champ visuel; suivant la dimension des surfaces en jeu, des changements d’adaptation générale ou locale apparaissent qui gênent l’exécution de la tâche. De plus, pour stimuler la performance, il est souhaitable que l’emplacement où s’effectue la tâche soit plus clair que son entourage immédiat et que les surfaces plus éloignées soient légèrement plus sombres.
Le temps de présentation de l’objet. La capacité de détection d’un objet dépend directement de la quantité de lumière pénétrant dans l’œil; or, cette quantité est liée à l’intensité et à la surface de l’objet, ainsi qu’au temps durant lequel il apparaît (tests de présentation tachystoscopique). L’acuité visuelle diminue quand la durée de présentation se situe au-dessous de 100 à 500 ms (millisecondes).
Les mouvements de l’œil ou de la cible. La perte de performance se manifeste en particulier durant les saccades; néanmoins, la stabilité totale de l’image n’est pas requise pour atteindre la meilleure résolution. On a montré que les vibrations, du type de celles des machines de chantier ou des tracteurs, pouvaient agir négativement sur l’acuité visuelle.
La diplopie. L’acuité visuelle est plus élevée en vision binoculaire qu’en vision monoculaire. Dans la vision binoculaire, les deux axes optiques doivent converger sur l’objet à percevoir, de manière que son image tombe dans des régions correspondantes de la rétine de chaque œil. Cela est rendu possible par l’activité des muscles oculaires. Si leur coordination est défaillante, des images doubles, plus ou moins transitoires, peuvent se former, comme on en observe dans l’extrême fatigue visuelle, et entraîner des sensations désagréables (Grandjean, 1987).
En bref, le pouvoir séparateur de l’œil est dépendant du type d’objet à percevoir et de l’environnement lumineux dans lequel on le mesure. Au cabinet médical, ces conditions sont optimales: contraste objet-fond le plus élevé possible, adaptation franchement photopique, caractères aux bords francs, présentation de l’objet sans limite de temps; enfin, une certaine redondance des signaux (par exemple, plusieurs lettres d’une même dimension sur une table de Snellen). De plus, l’acuité visuelle déterminée pour des raisons de diagnostic est une performance maximale et unique, sans intervention de la fatigue accommodative. L’acuité clinique reflète mal en cela la performance visuelle atteinte au poste de travail. Qui plus est, une bonne acuité clinique ne garantit pas nécessairement l’absence de gêne dans le travail où les conditions de confort visuel individuel sont rarement réalisées. Comme l’a souligné Krueger (1992), les objets qu’il appartient de distinguer au poste de travail sont très souvent flous et faiblement contrastés, les luminances de fond sont inégalement réparties, sans parler des nombreuses sources éblouissantes qui suscitent des effets de voile et d’adaptation locale, etc. D’après nos calculs, les résultats de l’examen clinique ne comportent pas un pouvoir prédictif fort quant à la quantité de fatigue et à la nature de cette fatigue rencontrée, par exemple, chez les opérateurs sur écran. Un appareillage de laboratoire plus proche des conditions de travail s’est révélé un peu meilleur (Rey et Bousquet, 1990; Meyer et coll., 1990).
Krueger (1992) a donc raison quand il affirme que l’examen ophtalmologique n’est guère approprié en médecine du travail et en ergonomie, que l’on devrait mettre au point de nouveaux tests et que les installations de laboratoire existantes devraient être mises à disposition des praticiens.
La vision binoculaire permet de réaliser une image unique par synthèse des images reçues par les deux yeux. Les analogies entre ces images donnent lieu à une coopération active qui constitue le mécanisme essentiel du sens de la profondeur et du relief. La vision binoculaire a en plus la propriété d’agrandir le champ visuel, d’améliorer d’une manière générale la performance visuelle, de soulager la fatigue et de renforcer la résistance à l’éblouissement.
Quand la fusion des deux yeux est insuffisante, la fatigue visuelle peut apparaître plus tôt.
La sensation du relief et la perception de la profondeur, sans atteindre l’efficacité de la vision binoculaire dans l’appréciation du relief des objets relativement proches, sont néanmoins accessibles à la vision monoculaire, par le truchement de phénomènes qui ne réclament pas la disparité binoculaire. Nous savons que la dimension des objets ne change pas; c’est pourquoi la dimension apparente intervient sur notre appréciation de la distance; ainsi, les images rétiniennes de faible dimension évoqueront des objets lointains et inversement (dimension apparente). Les objets proches tendent à cacher des objets plus éloignés (on parle d’interposition). Le plus brillant de deux objets, ou celui dont la couleur est plus saturée, semble plus proche. L’environnement joue aussi un rôle: les objets plus lointains se perdent dans la brume. Deux lignes parallèles semblent se rejoindre à l’infini (c’est l’effet de perspective). Enfin, si deux cibles se déplacent à la même vitesse, celle dont la vitesse de déplacement rétinien est plus lente apparaîtra plus éloignée de l’œil.
En fait, la vision monoculaire ne constitue pas un obstacle majeur dans la plupart des situations de travail. Il faut que le sujet s’habitue au rétrécissement de son champ visuel, ainsi qu’à la possibilité, plutôt exceptionnelle, que l’image de l’objet tombe sur la tache aveugle (on sait qu’en vision binoculaire, une même image ne tombe jamais en même temps sur la tache aveugle des deux yeux). Il faut noter aussi qu’une bonne vision binoculaire ne s’accompagne pas nécessairement d’une bonne vision du relief (stéréoscopique), car celle-ci dépend aussi de processus centraux complexes.
Pour toutes ces raisons, les contre-indications à l’emploi portant sur la vision stéréoscopique devraient être abandonnées au profit d’un examen approfondi, par l’ophtalmologue, des travailleurs. Des règlements et des recommandations existent cependant en la matière et la vision stéréoscopique est censée être indispensable dans des tâches telles que la conduite de grues, la bijouterie et la découpe. Il ne faut pas oublier toutefois que les nouvelles technologies peuvent modifier radicalement la nature du travail; ainsi, les machines-outils à commande numérique exigent probable-ment moins que les anciennes machines une vision stéréoscopique puissante.
En matière de conduite automobile, la réglementation diffère de pays à pays. Au tableau 11.4, on trouvera les exigences françaises pour la conduite soit de véhicules légers, soit de poids lourds. Les lecteurs américains se reporteront au règlement publié par l’Association médicale américaine (American Medical Associ- ation). Fox (1973) mentionne que, pour le ministère des Transports aux Etats-Unis, les conducteurs de véhicules commerciaux devaient, en 1972, avoir une acuité visuelle d’au moins 20/40, avec ou sans verres de correction; un champ visuel d’au moins 70 degrés était exigé pour chaque œil. Il fallait aussi pouvoir reconnaître les couleurs des feux de signalisation; mais, aujourd’hui, la distinction peut être faite non seulement par la couleur, mais aussi par la forme et la disposition des feux.
|
Acuité visuelle (avec correction) |
|
|
Véhicules légers |
Au moins 6/10 pour l’acuité binoculaire et au moins 2/10 pour l’œil le moins bon |
|
Poids lourds |
Au moins 10/10 pour l’acuité binoculaire et au moins 6/10 pour l’œil le moins bon |
|
Champ visuel |
|
|
Véhicules légers |
Pas de permis s’il y a une réduction du champ périphérique par un œil unique, ou lorsque l’acuité d’un des deux yeux est inférieure à 2/10 |
|
Poids lourds |
Intégrité totale des champs visuels (pas de réduction du champ, pas de scotome) |
|
Nystagmus (mouvements oculaires spontanés) |
|
|
Véhicules légers |
Pas de permis si l’acuité visuelle binoculaire est inférieure à 8/10 |
|
Poids lourds |
Aucun défaut en vision de nuit n’est accepté |
On en décrit plusieurs types qui ont tous pour objectif de permettre à l’œil de tirer bénéfice de toutes les informations contenues dans les images. Le système de fixation nous permet de maintenir en place, au niveau des récepteurs de la fovéa, l’objet qui peut alors être examiné dans la région rétinienne possédant le pouvoir de résolution le plus élevé. Néanmoins, les yeux sont constamment le lieu de micromouvements (trémor). Les saccades sont des mouvements rapides, induits lors d’un acte d’exploration visuelle, dont le but est de déplacer le regard d’un détail à l’autre de l’objet immobile; le cerveau perçoit ce mouvement imprévu comme le déplacement d’une image à travers la rétine. On rencontre cette illusion de mouvement dans les atteintes pathologiques du système nerveux central et de l’organe vestibulaire. Les mouvements de poursuite sont partiellement volontaires quand il s’agit de traquer de relativement petits objets, mais deviennent pratiquement irrépressibles quand on a affaire à de très grands objets. Plusieurs mécanismes de suppression d’images (dont les saccades) permettent de préparer la rétine à recevoir de nouvelles informations.
Les illusions du mouvement (mouvements autocinétiques) d’un point lumineux ou d’un objet immobile, telles que le mouvement d’un pont sur un cours d’eau, s’expliquent surtout par la persistance rétinienne et des conditions de vision non intégrées dans notre système central de référence. L’effet consécutif peut n’être qu’une simple erreur d’interprétation d’un message lumineux (parfois pernicieuse en milieu de travail) ou aboutir à des troubles neurovégétatifs graves. Les illusions causées par des figures statiques sont bien connues. Les mouvements des yeux lors de la lecture ont été mentionnés ci-dessus.
Quand l’œil est stimulé par une succession de lumières brèves, il ressent tout d’abord le papillotement puis, avec l’élévation de la fréquence, il éprouve l’impression d’une luminance stable: c’est la fréquence critique de fusion. Si la lumière stimulante oscille de manière sinusoïdale, le sujet peut éprouver la fusion pour toutes les fréquences situées au-dessous de la fréquence critique, pour autant que l’on réduise le taux de modulation de la stimulation. La courbe de de Lange, qui réunit tous ces seuils, subit différentes transformations quand la stimulation est modifiée: la courbe s’infléchit quand on réduit la luminance de la surface stimulante ou si le contraste entre celle-ci et son environnement lumineux décroît; des altérations du même genre peuvent s’observer sur la courbe de référence dans le cas de pathologies rétiniennes ou de traumatisme crânien (Meyer et coll., 1971) (voir figure 11.15).
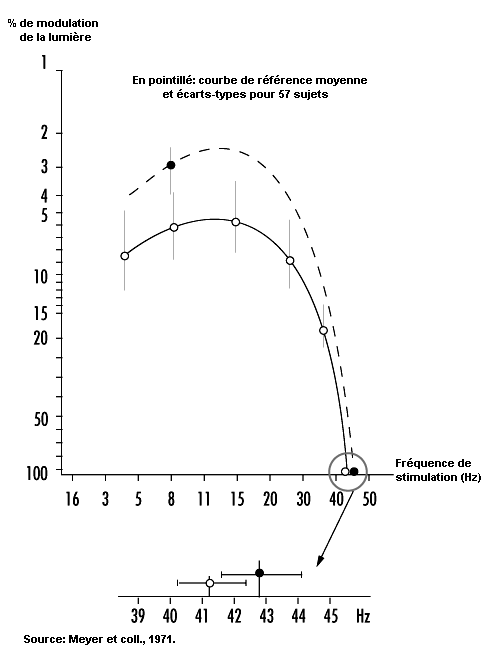
C’est pourquoi il faut se montrer prudent quand on prétend interpréter la chute des fréquences critiques de fusion en termes de fatigue visuelle due au travail.
La médecine du travail devrait faire un meilleur usage de la lumière intermittente pour détecter des lésions rétiniennes de petite dimension ou des troubles fonctionnels (dans les premiers temps d’une intoxication, par exemple, on peut observer une élévation de la courbe, laquelle sera suivie d’une chute quand l’intoxication deviendra plus sévère). Cette technique d’exploration — qui ne modifie pas l’adaptation rétinienne et qui ne nécessite pas d’être utilisée avec une correction optique parfaitement ajustée — est aussi très utile pour le suivi de la récupération fonctionnelle durant et après un traitement (Meyer et coll., 1983) (voir figure 11.16).
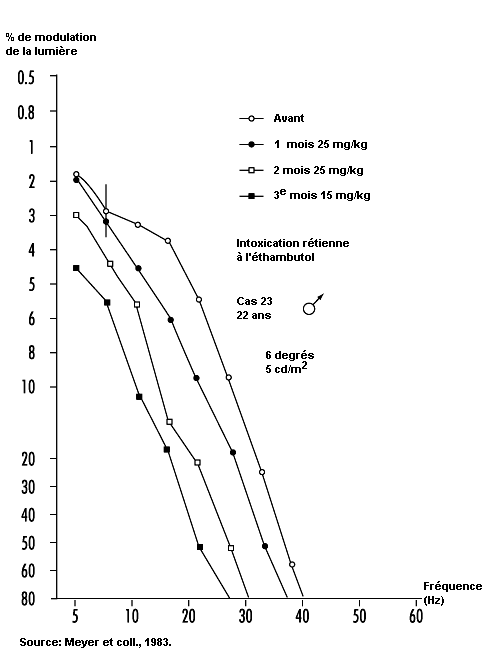
La sensation colorée est liée à l’activité des cônes et n’existe donc qu’en cas d’adaptation photopique ou mésopique. Pour que le système d’analyse des couleurs fonctionne d’une manière satisfaisante, la luminance des objets à percevoir doit être au moins de 10 cd/m2. De façon générale, trois sources colorées (couleurs primaires, rouge, vert et bleu) suffisent, par leurs combinaisons, à reproduire toute une gamme de sensations colorées. On observe, d’autre part, un phénomène d’induction de contraste coloré entre deux couleurs qui se renforcent mutuellement: la paire vert-rouge et la paire jaune-bleu.
Les deux théories de la sensation colorée, la trichromatique et la dichromatique, ne s’excluent pas; la première s’appliquerait à l’étage des cônes et la seconde aux niveaux plus centraux du système visuel.
Pour comprendre comment on perçoit les couleurs d’objets se détachant sur un fond lumineux, il faut faire appel à d’autres concepts. Une même couleur peut en effet être produite par différents types de rayonnements; pour reproduire fidèlement une couleur donnée, il faut donc connaître la composition spectrale des sources lumineuses et le spectre de réflec- tance des pigments. L’indice de rendu des couleurs des éclairagistes permet de sélectionner les tubes fluorescents en fonction des besoins. Notre œil a développé la faculté de détecter de très faibles changements de tonalité d’une surface obtenus par un changement de la composition spectrale de cette surface; les couleurs spectrales (l’œil en distingue plus de 200) recréées par des mélanges de lumières monochromatiques ne représentent qu’une petite partie de toutes les sensations colorées possibles.
A l’exception des activités telles que le contrôle de l’aspect des produits et celles des décorateurs, etc., où la couleur doit être correctement identifiée, il convient de ne pas exagérer l’importance des anomalies de la vision colorée en milieu de travail. De plus, y compris chez les électriciens, d’autres repères (la dimension ou la forme, par exemple) peuvent remplacer la couleur.
Les dyschromatopsies peuvent être congénitales ou acquises (dégénérescences). Chez les trichromates anormaux, l’altération peut toucher la sensation fondamentale rouge (type Dalton), la verte ou la bleue (anomalie la plus rare). Chez les dichromates, le système des trois fondamentales est réduit à deux. Dans la deutéranopie, c’est la fondamentale verte qui manque. Dans la protanopie, c’est la disparition de la fondamentale rouge; bien que moins fréquente, cette anomalie, qui s’accompagne d’une perte de luminosité dans la gamme des rouges, mérite que l’on y prête attention dans le milieu de travail, en évitant notamment les affichages rouges, surtout s’ils ne sont pas très bien éclairés. Notons encore que ces insuffisances de la vision colorée peuvent se retrouver, à des degrés divers, chez le sujet dit normal, ce qui renforce encore la nécessité d’utiliser les couleurs avec prudence, par exemple, de ne pas les multiplier. Il faut enfin garder en mémoire que seuls les gros défauts sont détectés par les appareils de dépistage.
Le punctum proximum (Weymouth, 1966) se trouve à la distance la plus courte où peut encore se réaliser la vision nette; le punctum remotum, le point le plus éloigné, se situe, chez l’œil emmétrope, à l’infini. Dans la myopie, le punctum remotum est situé en avant de la rétine; cet excès de puissance se corrige par des verres concaves. Pour l’œil hyperope ou hypermétrope, le punctum remotum se situe en arrière de la rétine; ce défaut de puissance se corrige par des verres convexes (voir figure 11.17).
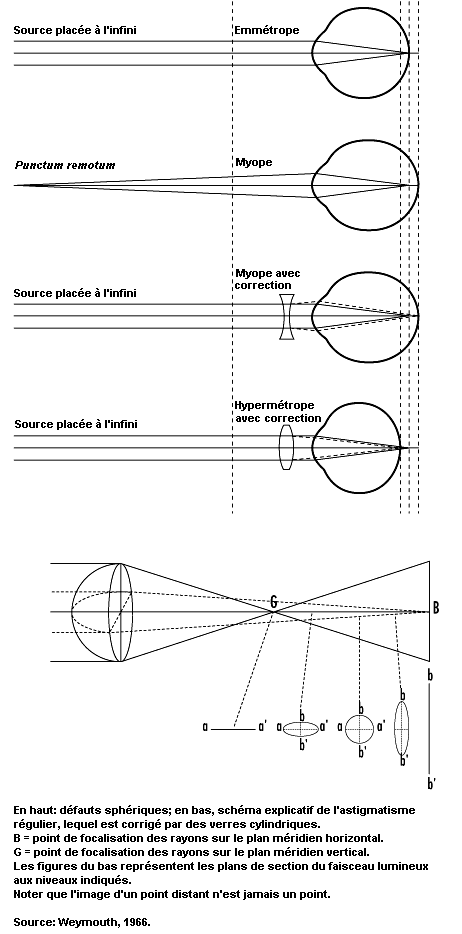
Dans l’hypermétropie légère, le défaut est corrigé spontanément par l’accommodation et peut être ignoré par l’individu qui en est atteint. Chez les myopes qui ne portent pas leurs lunettes, la perte d’accommodation peut être compensée par le rapprochement du punctum remotum.
Dans l’œil idéal, la surface de la cornée devrait être parfaitement sphérique; dans la réalité, les yeux présentent souvent des différences de courbure sur les différents méridiens (c’est l’astigmatisme); la réfraction est plus forte quand la courbure est plus accentuée, de sorte que les rayons issus d’un point lumineux ne forment pas une image ponctuelle sur la rétine. Ces défauts, quand ils sont importants, se corrigent à l’aide de verres cylindriques (voir le diagramme du bas à la figure 11.17); dans l’astigmatisme irrégulier, les lentilles de contact sont recommandées. L’astigmatisme devient particulièrement gênant dans la conduite nocturne ou dans le travail sur écran cathodique, c’est-à-dire dans des conditions où les signaux lumineux se détachent en clair sur un fond sombre, ou lors de l’utilisation d’un microscope binoculaire.
Les lentilles de contact ne devraient pas être portées aux postes de travail où l’air est trop sec, ou dans le cas de formation de poussières (Verriest et Hermans, 1975).
Dans la presbytie, qui est due à la perte d’élasticité du cristallin avec l’âge, c’est l’amplitude d’accommodation qui est réduite, soit la distance qui sépare le punctum proximum et le punctum remotum; celle-ci (d’environ 10 cm à l’âge de 10 ans) se réduit de plus en plus à mesure que l’on vieillit. La correction est assurée par des verres convergents, à foyer unique ou à foyers multiples; ces derniers corrigent la vue pour des distances toujours plus rapprochées de l’objet (généralement jusqu’à 30 cm), en prenant en compte que les objets les plus proches se perçoivent habituellement dans la partie inférieure du champ visuel, alors que la partie haute des lunettes est réservée à la vision de loin. On propose aujourd’hui des lunettes pour la lecture sur écran qui sont différentes du type décrit ci-dessus. Les verres dits progressifs estompent quasiment les limites entre les zones de correction. Il ne faut toutefois pas oublier que les verres progressifs demandent une accoutumance encore plus grande que pour les autres types de verres à multiples foyers, car leur champ de vision nette est très étroit (Krueger, 1992).
Quand la tâche visuelle réclame l’alternance de la vision de près et de la vision de loin, on recommande des lunettes bifocales ou trifocales et même des verres progressifs. Cependant, il faut savoir que le port de verres à foyers multiples peut modifier profondément la posture de l’opérateur. Ainsi, les opérateurs sur écran dont la presbytie est corrigée par des verres bifocaux habituels auront tendance à renverser la tête en arrière, ce qui pourra engendrer des douleurs à la nuque et aux épaules. Les fabricants conseillent alors différents modèles de verres progressifs. Une solution supplémentaire consiste à placer l’écran plus bas, dans la direction de lecture.
La mise en évidence des défauts de réfraction (qui sont fort nombreux dans la population active) est tributaire des moyens de mesure. Les tables de Snellen accrochées au mur ne donnent pas obligatoirement les mêmes résultats que différents types d’appareils où l’image de l’objet est projetée contre un fond proche. En réalité, dans un instrument de mesure de l’acuité visuelle (voir plus haut), on a de la peine à relâcher l’accommodation et cela d’autant plus que l’axe de visée est plus bas: c’est la «myopie instrumentale».
Avec l’âge, on assiste à la perte d’élasticité du cristallin, ce qui a pour conséquence l’éloignement du punctum remotum et la réduction du pouvoir d’accommodation. Bien que cette perte d’accommodation puisse être compensée par des lunettes, la presbytie constitue néanmoins un véritable problème de santé publique. Kauffmann (dans Adler, 1992) estime que son coût annuel, en termes de moyens correcteurs et de perte de productivité atteint, pour les seuls Etats-Unis, des dizaines de milliards de dollars. Dans les pays en développement, des travailleurs ont été obligés d’abandonner leur travail (dans la confection de saris de soie, par exemple), faute de pouvoir s’acheter des lunettes. De plus, il est très coûteux d’offrir, dans les postes dangereux pour les yeux, des lunettes apportant à la fois correction et protection. Il faut se rappeler que l’amplitude d’accommodation diminue déjà dans la seconde décennie de la vie (et peut-être même plus tôt) et qu’elle peut disparaître totalement dès l’âge de 50 à 55 ans (Meyer et coll., 1990) (voir figure 11.18).
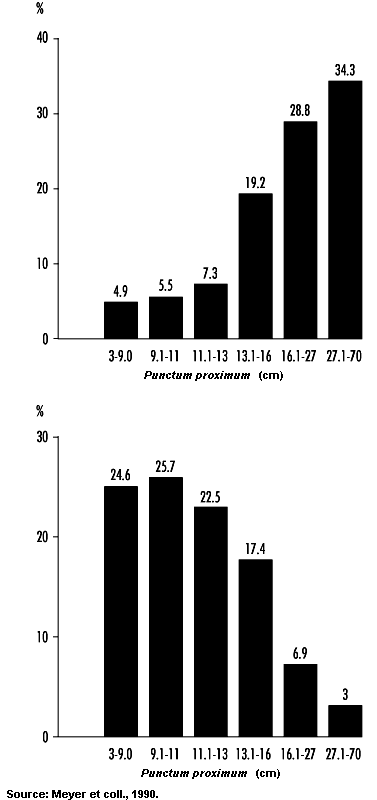
D’autres phénomènes se manifestent aussi: l’enfoncement de l’œil dans l’orbite, qui se produit plus ou moins suivant les individus dans le grand âge, réduit l’amplitude du champ visuel (du fait de la paupière); la dilatation pupillaire connaît son maximum dans l’adolescence, puis elle diminue; chez les personnes âgées, la pupille se dilate moins largement et la réaction pupillaire à la lumière est ralentie; la perte de transparence des milieux de l’œil amenuise l’acuité visuelle (certains milieux ont tendance à jaunir, ce qui altère la vision colorée) (Verriest et Hermans, 1975); l’élargissement de la tache aveugle entraîne un rétrécissement du champ visuel fonctionnel.
Avec l’âge et la maladie, on observe des altérations des vaisseaux rétiniens avec leurs conséquences fonctionnelles. Les mouvements oculaires eux-mêmes se modifient: il y a ralentissement et réduction d’amplitude des mouvements exploratoires.
Dans des conditions de faible contraste et de faible luminosité du milieu du travail, les travailleurs plus âgés sont doublement défavorisés: en premier lieu, ils ont besoin de plus de lumière pour voir un objet, mais, en même temps, ils bénéficient moins d’une augmentation de la luminosité puisqu’ils sont plus vite éblouis. Ce handicap est dû à la transformation des milieux transparents qui laissent passer moins de lumière et augmentent sa diffusion (effet de voile décrit plus haut). Leur inconfort visuel est aggravé par des changements brusques entre des zones fortement et faiblement éclairées (réaction pupillaire ralentie, adaptation locale plus difficile). Ces défauts sont particulièrement gênants dans le travail sur écran cathodique où il est, en effet, très malaisé de fournir un bon éclairage à la fois aux jeunes opérateurs et aux plus âgés; on peut remarquer, par exemple, que ces derniers vont tenter, par tous les moyens possibles, de diminuer la luminosité de leur environnement, alors même qu’un environnement faiblement éclairé affecte leur acuité visuelle.
Ces risques s’expriment de différentes manières (Rey et Meyer, 1981; Rey, 1991): par la nature de l’agent en cause (physique, chimique, etc.), par la voie de pénétration (cornée, sclérotique, etc.), par la nature des lésions (brûlures, déchirures, etc.), par la gravité des atteintes (limitées aux couches externes, atteignant la rétine, etc.), par les circonstances entourant l’accident (comme pour toute autre lésion corporelle). Ces éléments descriptifs permettent d’orienter la prévention. Seules les lésions oculaires et les circonstances rencontrées le plus fréquemment dans les statistiques d’assurance seront mentionnées ici. Il convient de souligner que la plupart des lésions oculaires ouvrent droit à réparation.
Elles s’observent surtout chez les tourneurs, polisseurs, fondeurs, chaudronniers, maçons et travailleurs des carrières. Les corps étrangers peuvent être des substances inertes, comme le sable, des métaux irritants, tels que le fer ou le plomb, des matières organiques d’origine animale ou végétale (poussières). C’est pourquoi, si la quantité de substance introduite dans le corps est suffisamment importante, des complications telles qu’infections et intoxications peuvent se produire en plus des lésions. Les lésions provoquées par les corps étrangers seront, bien entendu, plus ou moins invalidantes, selon que ces corps étrangers se seront arrêtés aux couches extérieures de l’œil ou qu’ils auront pénétré profondément dans le globe; c’est pourquoi le traitement sera de différente nature et qu’un transfert d’urgence à l’hôpital pourra parfois s’imposer.
Elles sont dues à des agents divers: éclairs ou flammes (lors de l’explosion de gaz); métal en fusion (la gravité de la lésion dépend du point de fusion, les métaux fondant à haute température entraînant les dommages les plus importants); les acides et les bases causent des brûlures chimiques. On trouve aussi des brûlures à l’eau bouillante, des brûlures électriques et bien d’autres.
Ils sont très fréquents. Deux phénomènes y contribuent: la force du jet lui-même (et les corps étrangers accélérés par le flux d’air); la forme de la buse, un jet moins concentré étant moins nocif.
La source de rayonnement est soit le soleil, soit certaines lampes. Le degré de pénétration de l’œil (par conséquent, le danger de l’exposition) dépend des longueurs d’onde; trois zones ont été délimitées par la Commission internationale de l’éclairage (CIE): les UVC (280 à 100 nm) sont absorbés au niveau de la cornée et de la conjonctive; les UVB (315 à 280 nm) atteignent le segment antérieur de l’œil; les UVA (400 à 315 nm) pénètrent encore davantage.
Chez les soudeurs, les effets caractéristiques de l’exposition sont connus: kératoconjonctivite aiguë, photo-ophtalmie chronique avec troubles de la vision, etc.; le soudeur est aussi soumis à une quantité importante de lumière visible et doit se protéger avec des filtres adéquats. L’ophtalmie des neiges, atteinte douloureuse présente chez les travailleurs en altitude, peut être évitée par le port de verres protecteurs adéquats.
Il est situé entre le rayonnement visible et les ondes radioélectriques les plus courtes et commence, selon la CIE, à 750 nm. La pénétration dans l’œil dépend de la longueur d’onde, les rayons infrarouges les plus longs étant susceptibles d’atteindre le cristallin et même la rétine. Leur propriété est d’être calorigènes. La maladie caractéristique est la cataracte des verriers qui soufflent le verre en face du four. D’autres catégories de travailleurs peuvent souffrir du rayonnement thermique, comme les travailleurs des hauts fourneaux, avec des effets cliniques divers (tels que la kératoconjonctivite, épaississement membraneux de la conjonctive, etc.)
La longueur d’onde de l’émission dépend du type de laser — lumière visible, ultraviolet et infrarouge. C’est surtout la quantité d’énergie propulsée qui détermine le niveau de danger encouru.
Le rayonnement ultraviolet peut provoquer des lésions inflammatoires; le rayonnement infrarouge des lésions caloriques; mais le risque le plus grand est la destruction du tissu rétinien par le faisceau lui-même, avec perte de vision dans la région touchée.
Les émissions en provenance des écrans cathodiques utilisés communément en bureautique (rayons X, ultraviolets, infrarouges, radiations hertziennes) sont toutes situées au-dessous des normes internationales. D’après Rubino (1990), rien ne corrobore la thèse selon laquelle le travail à l’écran pourrait induire une cataracte.
Certains solvants, comme les esters et les aldéhydes (notamment le formaldéhyde d’utilisation courante) sont irritants pour les yeux. Les acides inorganiques, dont l’action corrosive est bien connue, sont responsables de destructions tissulaires et de brûlures chimiques par contact. Les acides organiques sont aussi dangereux. Les alcools sont des irritants. La soude caustique, base extrêmement forte, est un corrosif puissant qui s’attaque aux yeux et à la peau. Dans la liste des substances nocives (Grant, 1979), on rencontre aussi certaines matières plastiques, certaines poussières inorganiques et organiques et des matières aux propriétés allergéniques: bois exotiques, plumes, etc.
Enfin, les maladies infectieuses professionnelles peuvent s’accompagner d’une affection oculaire.
Le port de protections individuelles (lunettes ou masques) peut gêner la vision (diminution de l’acuité visuelle par perte de transparence des verres rayés par les projections de corps étrangers; obstacles dans le champ visuel, comme les branches de lunettes); c’est pourquoi, l’hygiène du poste de travail doit consister aussi à réduire le risque par des moyens de prévention techniques tels que l’aspiration des poussières et particules dangereuses et la ventilation générale des locaux.
Le médecin du travail est souvent appelé à donner son avis sur la qualité des lunettes qui doivent être adaptées au risque; des directives nationales et internationales le guideront dans ce choix. De plus, des protections oculaires toujours plus efficaces se présentent sur le marché, conçues également pour apporter confort et même esthétique.
Aux Etats-Unis, on peut se reporter aux normes ANSI (en particulier ANSI Z87.1-1979) qui ont force de loi en vertu de la loi fédérale sur la sécurité et la santé au travail (Fox, 1973). La norme ISO no 4007-1977 concerne aussi les moyens de protection individuelle. En France, on peut se procurer des directives et du matériel de protection auprès de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), à Nancy. En Suisse, la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (CNA) fournit des recommandations et des directives pour l’extraction des corps étrangers au poste de travail. Pour les lésions graves, il est préférable d’envoyer le travailleur blessé chez l’ophtalmologiste ou dans un service hospitalier spécialisé.
Enfin, les travailleurs qui sont porteurs d’une pathologie oculaire peuvent être davantage menacés que les autres dans leur activité professionnelle; les controverses concernant les contre-indications à l’emploi dépassent les objectifs du présent article. Mais, comme déjà mentionné, les ophtalmologistes se doivent de connaître les dangers qui guettent leurs patients au poste de travail et les surveiller en conséquence.
Au poste de travail, la plus grande partie des informations et des signaux reçus sont de nature visuelle, bien que les signaux acoustiques ne soient pas négligeables et que l’on doive attribuer leur juste importance aux informations tactiles, en particulier dans le travail manuel ou de bureau (frappe du clavier, notamment).
Notre connaissance de l’œil et de la vision provient essentiellement de deux sources: clinique et expérimentale. Pour les besoins du diagnostic des défauts et des maladies oculaires, on a mis au point des techniques de mesure des fonctions visuelles; ces procé-dés ne sont pas nécessairement les mieux appropriés au dépistage en milieu de travail. Les conditions de l’examen médical sont en effet fort éloignées de celles qui règnent au poste de travail; ainsi, pour déterminer l’acuité visuelle, l’ophtalmologiste fera usage d’optotypes (tables de Snellen) ou d’appareils où le contraste entre l’objet à percevoir et le fond est le meilleur possible, où les bords des objets sont nets et où il n’y a pas de source éblouissante perceptible, etc. Dans la vie réelle, les conditions d’éclairage sont souvent médiocres et l’astreinte visuelle peut durer plusieurs heures de suite.
C’est pourquoi il faut mettre l’accent sur l’utilisation de l’instrumentation nouvelle disponible en laboratoire, qui possède un pouvoir prédictif élevé concernant la fatigue visuelle au poste de travail.
On ne compte pas les expériences scientifiques menées pour mieux comprendre les mécanismes de la vision qui sont d’une grande complexité. Seules sont citées ici les connaissances qui ont une utilité directe pour la santé au travail.
Si des affections pathologiques peuvent empêcher certaines personnes d’accomplir leur tâche, il paraît plus utile et plus correct — exception faite d’activités très exigeantes et qui sont réglementées (l’aviation, par exemple) — de donner davantage de pouvoir de décision à l’ophtalmologiste dans le but de protéger son patient, plutôt que de recourir d’une manière automatique à des directives générales, et c’est ce qui se passe dans de nombreux pays. Des guides utiles peuvent être consultés pour plus de renseignements.
Il n’en reste pas moins que des risques pour les yeux existent lorsque les travailleurs sont exposés sur le lieu de travail à des agents nocifs, physiques ou chimiques. Les risques pour les yeux existant dans l’industrie ont été succinctement énumérés. Par ailleurs, d’après les expériences scientifiques, on est fondé à penser que le travail sur écran de visualisation ne présente pas le risque de provoquer une cataracte.
Les trois sens chimiosensibles, l’odorat, le goût et le sens chimique commun, doivent être stimulés directement par des substances chimiques pour fournir une perception sensorielle. Ils ont pour rôle de détecter en permanence les substances chimiques inhalées ou ingérées, qu’elles soient bénéfiques ou nocives. Le sens chimique commun fournit les sensations d’irritation ou de picotement. Le sens du goût ne perçoit que les saveurs sucrées, salées, acides et amères et, éventuellement, les goûts de métal et de glutamate monosodique (umami). On appelle l’ensemble des perceptions sensorielles buccales «flaveur», celle-ci étant la somme de l’odeur, du goût, de l’irritation, de la texture et de la température. La flaveur étant due principalement à l’odeur ou à l’arôme des aliments ou des boissons, on parle d’une atteinte du sens de l’odorat comme s’il s’agissait d’un problème de «goût». Pour qu’il y ait un véritable déficit gustatif, il faut que le sujet fasse état de pertes spécifiques des sensations de sucré, d’acide, de salé ou d’amer.
Les problèmes de chimiosensibilité sont fréquents dans le milieu de travail et peuvent résulter de la perception des produits chimiques ambiants par un système sensoriel normal. Mais ils peuvent également indiquer une atteinte du système sensoriel que le contact inévitable avec les substances chimiques rend exceptionnellement vulnérable (voir tableau 11.5). Dans le milieu de travail, les systèmes sensoriels peuvent aussi être affectés par des traumatismes crâniens ou par des agents non chimiques (rayonnements, par exemple). Les troubles gustatifs peuvent être passagers ou permanents: perte partielle ou totale du sens du goût (hypogueusie ou agueusie), exagération de la sensibilité gustative (hypergueusie) et sensations gustatives anormales ou imaginaires (dysgueusie) (Deems, Doty et Settle, 1991; Mott, Grushka et Sessle, 1993).
|
Substances/opérations |
Trouble du goût |
Référence |
|
Acide sulfurique (vapeurs) |
«Mauvais goût» |
Petersen et Gormsen, 1991 |
|
Amalgame |
Goût métallique |
Siblerud 1990; voir texte |
|
Hydrazine |
Goût sucré |
Schweisfurth et Schottes, 1993 |
|
Hydrocarbures |
Hypogueusie, goût de «colle» |
Hotz et coll., 1992 |
|
Médicaments |
Variable |
Voir texte |
|
Métaux et fumées métalliques |
Goût sucré/métallique |
Voir texte; Shusterman et Sheedy, 1992 |
|
Nickel |
Goût métallique |
Pfeiffer et Schwickerath, 1991 |
|
Pesticides (organophosphorés) |
Amer/goût métallique |
+ |
|
Plomb (intoxication) |
Sucré/goût métallique |
Kachru et coll., 1989 |
|
Plongée (saturation sèche) |
Sucré, amer, salé, acide |
Voir texte |
|
Prothèses dentaires |
Goût métallique |
Voir texte |
|
Rayonnements |
Elévation du SD et du SR |
* |
|
Sélénium |
Goût métallique |
Bedwal et coll., 1993 |
|
Solvants |
«Drôle de goût», H |
+ |
|
Soudure sous-marine |
Goût métallique |
Voir texte |
|
Vanadium |
Goût métallique |
Nemery, 1990 |
SD = seuil de détection; SR = seuil de reconnaissance; * = Mott et Leopold, 1991; + = Schiffman et Nagle, 1992.
Les troubles gustatifs spécifiques sont indiqués dans les articles cités.
Le système gustatif est protégé par sa capacité de régénération et par une innervation importante. De ce fait, les troubles gustatifs cliniquement enregistrables sont plus rares que les troubles olfactifs. Les dysgueusies sont plus fréquentes que les véritables agueusies et, lorsqu’elles existent, elles peuvent entraîner davantage d’effets secondaires néfastes, tels qu’anxiété ou dépression. Les unes et les autres peuvent nuire à l’activité professionnelle quand celle-ci exige une grande acuité gustative, comme dans l’art culinaire et le coupage des vins et des alcools.
Les cellules gustatives réceptrices, réparties dans toute la cavité buccale, le pharynx, le larynx et l’œsophage, sont des cellules épithéliales modifiées, situées dans les bourgeons gustatifs. Sur la langue, les bourgeons gustatifs sont groupés en organes superficiels appelés papilles, tandis que les bourgeons gustatifs extralinguaux sont dispersés sur l’épithélium. La situation superficielle des cellules gustatives les rend vulnérables. Les agents agressifs entrent généralement en contact par ingestion, mais une respiration par la bouche, lors d’une obstruction nasale ou d’autres conditions (asthme ou exercice, par exemple) permet à des agents en suspension dans l’air d’entrer en contact avec la muqueuse buccale. La durée de vie moyenne de dix jours des cellules gustatives réceptrices permet une récupération rapide en cas de lésions superficielles. De plus, l’appareil gustatif est innervé par quatre paires de nerfs périphériques: pour l’avant de la langue, par la corde du tympan du septième nerf crânien (NC VII ), pour l’arrière de la langue et le pharynx, par le nerf glossopharyngien (NC IX ), pour le palais mou, par le grand rameau pétreux superficiel du NC VII et pour le larynx et l’œsophage, par le nerf vague (NC X). Enfin, les voies gustatives centrales, bien qu’incomplètement topographiées chez l’humain (Ogawa, 1994), semblent plus divergentes que les voies olfactives centrales.
La première étape de la perception gustative implique une interaction entre les substances chimiques et les cellules réceptrices. Les quatre saveurs fondamentales du goût — sucrée, salée, amère et acide — mettent en jeu des mécanismes différents au niveau du récepteur (Kinnamon et Getchell, 1991), pour engendrer finalement des potentiels d’action dans les neurones gustatifs (transduction).
Les substances sapides diffusent dans la salive et le mucus sécrétés autour des cellules gustatives pour interagir avec la surface de celles-ci. La salive assure le transport des substances sapides jusqu’aux bourgeons et fournit également un environnement ionique optimal pour la perception (Spielman, 1990). Il a été démontré que des modifications des composants inorganiques de la salive altèrent le goût. La plupart des substances sapides sont hydrosolubles et diffusent facilement; d’autres exigent des protéines de transport solubles. Le débit et la composition de la salive jouent ainsi un rôle essentiel dans la fonction gustative.
La saveur salée est stimulée par les cations tels que Na+, K+ ou NH4+. La transduction de la plupart des stimuli salés se fait lorsque les ions passent à travers un type spécifique de canal sodique (Gilbertson, 1993), mais d’autres mécanismes peuvent aussi entrer en jeu. Des modifications du mucus des pores gustatifs ou de l’environnement des cellules gustatives pourraient altérer la saveur salée. Des modifications structurelles des protéines réceptrices avoisinantes pourraient aussi affecter le fonctionnement de la membrane réceptrice. La saveur acide correspond effectivement à une acidité. Elle est engendrée par le blocage de canaux sodiques spécifiques par les ions hydrogène. Comme pour la saveur salée, on pense qu’il existe d’autres mécanismes. De nombreuses substances chimiques sont perçues comme amères et, parmi celles-ci, les cations, les acides aminés, les peptides et des molécules plus volumineuses. La détection des stimuli amers réclame, elle, la participation de mécanismes plus variés mettant en jeu des protéines vectrices, des canaux cationiques, des protéines G et des seconds messagers véhiculés par les réseaux nerveux (Margolskee, 1993). Les protéines salivaires sont essentielles pour le transport des stimuli amers lipophiles jusqu’aux membranes réceptrices. Les stimuli sucrés se lient à des récepteurs spécifiques associés à des systèmes de seconds messagers activés par la protéine G. Chez les mammifères, on a constaté que les stimuli sucrés peuvent traverser directement les canaux ioniques (Gilbertson, 1993).
La diversité et la surabondance anatomiques du système gustatif le protègent suffisamment pour empêcher une agueusie totale et permanente. La perte de quelques aires gustatives périphériques, par exemple, ne devrait pas affecter la capacité gustative globale de la bouche (Mott, Grushka et Sessle, 1993). Le système gustatif est sans doute beaucoup plus sensible à la dysgueusie et aux illusions gustatives. Les dysgueusies semblent ainsi beaucoup plus fréquentes dans les expositions professionnelles que les agueusies. Le goût est considéré comme plus résistant que l’odorat au vieillissement; toutefois, on a constaté que la perception gustative diminue avec l’âge.
Des agueusies passagères peuvent se produire lorsque la muqueuse buccale a été irritée. Théoriquement, il peut se produire une inflammation des cellules gustatives, une fermeture des pores gustatifs ou une altération fonctionnelle de la surface des cellules gustatives. L’inflammation peut altérer l’irrigation sanguine de la langue, affectant de ce fait le goût. La sécrétion salivaire peut aussi être diminuée. Les substances irritantes peuvent provoquer un gonflement et obstruer les canaux salivaires. Les substances toxiques introduites dans l’organisme et qui sont éliminées par les glandes salivaires peuvent léser les tissus canaliculaires au moment de l’excrétion. Chacun de ces mécanismes peut provoquer une sécheresse prolongée de la bouche influant sur la fonction gustative. L’exposition à des substances toxiques peut modifier la vitesse de renouvellement des cellules gustatives, altérer les canaux gustatifs à la surface des cellules gustatives, ou l’environnement chimique interne ou externe des cellules. De nombreuses substances sont connues comme neurotoxiques et pourraient léser directement les nerfs gustatifs périphériques ou léser les voies gustatives cérébrales.
Les pesticides sont largement utilisés et se retrouvent sous forme résiduelle dans la viande, les légumes, le lait, l’eau de pluie et l’eau de boisson. Même si les travailleurs exposés au cours de la fabrication ou de l’utilisation des pesticides sont les plus menacés, la population dans son ensemble n’est pas à l’abri de tout danger. Les pesticides importants comprennent les organochlorés, les organophosphorés et les carbamates. Les pesticides organochlorés sont très stables et persistent ainsi longtemps dans l’environnement. Ils ont des effets toxiques directs sur les neurones centraux. Les pesticides organophosphorés, quant à eux, sont plus souvent utilisés que les pesticides organochlorés, car ils sont moins durables, mais ils sont plus toxiques: en inhibant l’acétylcholinestérase, ils peuvent provoquer des troubles neurologiques et comportementaux. La toxicité des carbamates est semblable à celle des pesticides organophosphorés et on les utilise souvent, lorsque ces derniers se sont montrés inefficaces. L’exposition aux pesticides a pour effets des goûts amers ou métalliques persistants (Schiffman et Nagle, 1992), des dysgueusies non précisées (Ciesielski et coll., 1994) et, moins souvent, des agueusies. Les pesticides peuvent être transmis aux récepteurs gustatifs par l’air, l’eau et les aliments; ils peuvent également être absorbés par la peau, le tube digestif, la conjonctive et les voies respiratoires. De nombreux pesticides sont liposolubles; c’est pourquoi ils traversent facilement les membranes lipidiques de l’organisme. L’interférence avec le goût se produit au niveau périphérique, quelle que soit la voie d’exposition initiale; chez la souris, on a constaté la fixation sur la langue de certains insecticides injectés dans le sang. On a mis en évidence des altérations morphologiques des bourgeons gustatifs après exposition aux pesticides. On a également observé des lésions dégénératives des terminaisons nerveuses sensorielles qui peuvent expliquer des anomalies de la transmission nerveuse. Les dysgueusies métalliques peuvent provenir d’une paresthésie causée par l’action des pesticides sur les bourgeons gustatifs et leurs terminaisons nerveuses afférentes. Certaines indications portent à penser, toutefois, que les pesticides peuvent interférer avec les neurotransmetteurs et interrompre ainsi la conduction des perceptions gustatives vers les centres nerveux (El-Etri et coll., 1992). Les travailleurs exposés aux pesticides organophosphorés peuvent présenter des anomalies neurologiques à l’électro-encéphalographie et dans les tests neuropsychologiques, indépendamment d’une baisse de la cholinestérase dans le sang. On pense que ces pesticides ont un effet neurotoxique sur le cerveau, indépendant de leur action sur la cholinestérase. Une augmentation de la sécrétion salivaire a été associée à l’exposition aux pesticides, mais son effet possible sur le goût est mal connu.
Des altérations du goût sont apparues après exposition à certains métaux et composés métalliques, dont le mercure, le cuivre, le sélénium, le tellure, le cyanure, le vanadium, le cadmium, le chrome et l’antimoine. Des goûts métalliques ont également été notés chez des travailleurs exposés à des émanations d’oxyde de zinc ou de cuivre, à la suite d’ingestion de sels de cuivre ayant provoqué une intoxication, ou à la suite d’exposition à des émanations résultant de la coupe de tuyaux de laiton au chalumeau.
L’exposition à des émanations d’oxydes de métaux néoformés peut être responsable d’un syndrome appelé fièvre des métaux (Gordon et Fine, 1993). Si l’oxyde de zinc est le plus souvent cité, cette affection a également été observée après exposition à des oxydes d’autres métaux, tels que le cuivre, l’aluminium, le cadmium, le plomb, le fer, le magnésium, le manganèse, le nickel, le sélénium, l’argent, l’antimoine et l’étain. Le syndrome a été observé pour la première fois chez des fondeurs de laiton, mais il est aujourd’hui le plus fréquemment constaté dans la soudure d’acier galvanisé ou la galvanisation de l’acier. Dans les heures suivant l’exposition, une irritation de la gorge et une dysgueusie métallique ou sucrée peuvent annoncer des symptômes de fièvre, de frissons et de myalgies. D’autres symptômes, tels que toux ou céphalée, peuvent également se manifester. Ce syndrome se distingue à la fois par sa résolution rapide (en quarante-huit heures) et par le développement d’une tolérance après des expositions répétées aux oxydes métalliques. Pour expliquer ces troubles, un certain nombre de mécanismes ont été envisagés, dont des réactions du système immunitaire et un effet toxique direct sur les tissus respiratoires, mais on pense maintenant que l’exposition des poumons aux émanations de métaux provoque la libération dans le sang de médiateurs spécifiques, les cytokines, responsables des symptômes observés (Blanc et coll., 1993). Une forme plus sévère et potentiellement mortelle de fièvre des métaux se produit après exposition à un aérosol de chlorure de zinc libéré par les bombes fumigènes militaires (Blount, 1990). La fièvre par émanation de polymères ressemble par ses manifestations à la fièvre des métaux, hormis l’absence de dysgueusie métallique (Shusterman, 1992).
Un goût métallique sucré est souvent mentionné dans le saturnisme. On a constaté que des travailleurs fabriquant des bijoux en argent et présentant une intoxication par le plomb confirmée présentaient des symptômes de dysgueusie (Kachru et coll., 1989). Ces travailleurs étaient exposés à des vapeurs de plomb en fondant des déchets d’argent dans des ateliers mal ventilés. Les vapeurs contaminaient leurs cheveux et leur peau, ainsi que leurs vêtements, l’eau et les aliments.
Les plongeurs se plaignent de gêne buccale, de déstabilisation de leurs obturations dentaires et de goûts métalliques au cours des travaux de soudure ou de coupe de métaux à l’électricité effectués sous l’eau. Dans une étude réalisée par Örtendahl, Dahlén et Röckert (1985), sur 118 plongeurs utilisant du matériel électrique sous l’eau, 55% ont décrit des goûts métalliques, contrairement aux plongeurs n’effectuant pas ce travail. Dans une étude complémentaire, 40 plongeurs ont été répartis en deux groupes. Le groupe pratiquant sous l’eau des sections et des soudures à l’électricité présentait, avec une fréquence significativement supérieure, une déstabilisation des amalgames dentaires. On a supposé au début que des courants électriques intrabuccaux corrodaient l’amalgame et libéraient des ions métalliques agissant directement sur les cellules gustatives. Des études ultérieures ont mis en évidence une activité électrique intrabuccale insuffisante pour corroder l’amalgame, mais suffisante pour stimuler directement les cellules gustatives et produire un goût métallique (Örtendahl, 1987; Frank et Smith, 1991). Les plongeurs peuvent être sujets à des modifications du goût en l’absence de travaux de soudure; des effets différenciés sur la qualité de la perception des saveurs ont été démontrés, tels qu’une diminution de la sensibilité au sucré et à l’amer et une augmentation de la sensibilité au salé et à l’acide (O’Reilly et coll., 1977).
Dans une vaste étude prospective longitudinale portant sur des personnes ayant eu des soins dentaires et des prothèses, 5% environ des sujets ont signalé un goût métallique à un moment donné (Participants of SCP Nos. 147/242 et Morris, 1990). S’il y avait des antécédents de grincements de dents, la fréquence du goût métallique était supérieure; de même, la fréquence augmentait davantage avec les prothèses partielles fixes qu’avec les couronnes et d’autant plus que les prothèses partielles fixes étaient plus nombreuses. Les interactions entre les obturations et l’environnement buccal sont complexes (Marek, 1992) et peuvent affecter le goût par différents mécanismes. Les métaux se liant à des protéines peuvent acquérir des propriétés antigéniques (Nemery, 1990) et pourraient provoquer des réactions allergiques altérant le goût. Des débris et des ions métalliques solubles sont libérés et peuvent réagir avec les tissus mous de la cavité buccale. Une corrélation a été mise en évidence entre le goût métallique et la dissolution, dans la salive, du nickel des appareils dentaires (Pfeiffer et Schwickerath, 1991). Un goût métallique a été signalé par 16% des personnes ayant des obturations, mais par aucune de celles n’en ayant pas (Siblerud, 1990). De la même façon, chez les personnes dont l’amalgame avait été retiré, les goûts métalliques se sont améliorés ou ont diminué chez 94% d’entre elles (Siblerud, 1990).
Le galvanisme buccal, diagnostic controversé (Council on Dental Materials, Instruments and Equipment, 1987), serait la production de courants buccaux sous l’effet de la corrosion d’obturations dentaires ou de différences électrochimiques entre métaux intrabuccaux dissemblables. Les patients considérés comme affectés de galvanisme buccal semblent souffrir, avec une grande fréquence (63%), d’une dysgueusie décrite comme des saveurs métalliques, des goûts salés, désagréables ou semblables à l’effet d’une pile électrique (Johansson, Stenman et Bergman, 1984). En théorie, les courants électriques intrabuccaux peuvent stimuler directement les cellules gustatives et provoquer une dysgueusie. On a établi que les personnes éprouvant des sensations de brûlure buccale, de goût métallique ou une sensation d’électricité ou de galvanisme buccal ont des seuils électrogustométriques inférieurs à ceux des sujets témoins (c’est-à-dire une plus grande sensibilité gustative) (Axéll, Nilner et Nilsson, 1983). On peut discuter cependant le rôle effectif de courants galvaniques produits par le matériel dentaire. On pense qu’il est possible de ressentir un goût bref de papier d’aluminium après des soins dentaires, mais des effets plus durables sont sans doute improbables (Council on Dental Materials, Instruments and Equipment, 1987). Yontchev, Carlsson et Hedegard (1987) ont constaté des fréquences semblables du goût métallique ou des brûlures buccales, même lorsqu’il n’y avait pas de contact entre des produits de restauration dentaire chez les sujets en cause. D’autres explications des troubles gustatifs chez les patients porteurs d’obturations ou de prothèses sont une sensibilité au mercure, au cobalt, au chrome, au nickel ou à d’autres métaux (Council on Dental Materials, Instruments and Equipment, 1987), des affections buccales (périodontite, par exemple), une xérostomie, des anomalies de la muqueuse, des affections médicales ou les effets secondaires de médicaments.
De nombreux médicaments ont été mis en cause dans les altérations du goût (Frank, Hettinger et Mott, 1992; Mott, Grushka et Sessle, 1993; Della Fera, Mott et Frank, 1995; Smith et Burtner, 1994) et on les évoque ici en raison des expositions professionnelles possibles au cours de leur fabrication. Les principales catégories de médicaments en cause sont les antibiotiques, les anti- convulsivants, les hypolipémiants, les antitumoraux, les psychotropes, les antiparkinsoniens, les antithyroïdiens, les antiarthrosiques, les médicaments cardio-vasculaires et les produits d’hygiène dentaire.
Le site présumé d’action des médicaments sur l’appareil gustatif varie. Souvent, le goût du médicament est perçu directement lors de son absorption; dans d’autres cas, le médicament ou ses métabolites sont perçus après avoir été excrétés dans la salive. De nombreux médicaments, comme les anticholinergiques et certains antidépresseurs, provoquent une sécheresse de la bouche et affectent le goût, la salive, en quantité réduite ne pouvant pas transporter suffisamment de substance sapide jusqu’aux cellules gustatives. Certains médicaments agissent directement sur les cellules gustatives. Celles-ci ont un taux de renouvellement élevé et sont ainsi particulièrement exposées aux effets des médicaments inhibant la synthèse des protéines comme les antitumoraux. La possibilité d’un effet sur la transmission de l’influx véhiculé par les nerfs gustatifs ou dans les cellules ganglionnaires a aussi été envisagée, de même qu’une modification du décodage des stimuli dans les centres gustatifs supérieurs. On a signalé une dysgueusie en rapport avec le lithium, peut-être due à des transformations dans les canaux ioniques des récepteurs. Les antithyroïdiens et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (captopril ou énalapril, par exemple) sont des causes bien connues d’altération du goût, en raison peut-être de la présence d’un groupe sulfhydrile (SH) (Mott, Grushka et Sessle, 1993). D’autres médicaments comprenant des radicaux SH (méthimazole, pénicillamine, notamment) provoquent également des anomalies gustatives. Les médicaments agissant sur les neurotransmetteurs pourraient éventuellement altérer les perceptions gustatives.
Les mécanismes de ces altérations du goût varient cependant à l’intérieur même d’une catégorie de médicaments. L’altération consécutive à un traitement par la tétracycline peut être due à une mycose buccale. Une augmentation de l’azote uréique du sang, en rapport avec l’effet catabolique de la tétracycline, peut causer un goût métallique ou, parfois, un goût semblable à celui de l’ammoniac.
Les effets indésirables du métronidazole comprennent des altérations du goût, des nausées et une modification caractéristique du goût des boissons gazeuses et alcoolisées. Il peut se produire parfois des neuropathies périphériques et des paresthésies. On pense que le médicament et ses métabolites peuvent avoir un effet direct sur les cellules sensorielles et le fonctionnement des récepteurs gustatifs.
La radiothérapie peut provoquer des dysgueusies par: 1) une modification des cellules gustatives; 2) des lésions des nerfs gustatifs; 3) un dysfonctionnement des glandes salivaires; et 4) des infections buccales opportunistes (Della Fera et coll., 1995). Les effets des expositions professionnelles aux rayonnements sur l’appareil gustatif n’ont pas été étudiés.
Des traumatismes crâniens peuvent se produire dans le cadre du travail et provoquer des dysgueusies. Alors que seuls 0,5% des patients ayant subi un traumatisme crânien font état d’une agueusie, la fréquence de la dysgueusie peut être beaucoup plus élevée (Mott, Grushka et Sessle, 1993). L’agueusie sera probablement spécifique d’une saveur, ou localisée, et pourra même ne pas être perçue subjectivement. Le pronostic de l’agueusie perçue subjectivement semble meilleur que celui de l’anosmie.
D’autres causes de troubles gustatifs doivent être prises en considération dans le diagnostic différentiel, notamment les affections congénitales/génétiques, endocrines/métaboliques, gastro-intestinales ou hépatiques; les manifestations iatrogéniques; les infections; les affections buccales locales; le cancer; les troubles neurologiques; les troubles psychiatriques; les affections rénales et la sécheresse de la bouche/syndrome de Sjögren (Deems, Doty et Settle, 1991; Mott et Leopold 1991; Mott, Grushka et Sessle, 1993).
La psychophysique mesure la réponse à l’application d’une stimulation sensorielle. Les tests de «seuil», qui déterminent la concentration minimale pouvant être perçue fiablement, sont moins utiles pour le goût que pour l’odorat, en raison de la plus grande variabilité du goût dans la population en général. Des seuils distincts peuvent être obtenus pour la détection des substances sapides et la reconnaissance de leur nature. Les tests supraliminaires évaluent la capacité de fonctionnement du système gustatif à des niveaux supérieurs au seuil et peuvent fournir davantage d’informations sur les expériences gustatives vécues. Les tests de discrimination, où le sujet doit différencier des substances, peuvent révéler des modifications subtiles des capacités sensorielles. Chez un même individu, les tests d’identification peuvent donner des résultats différents des tests de seuil. Par exemple, une personne présentant une lésion du système nerveux central peut être capable de détecter et de catégoriser les substances sapides, mais non de les identifier. Les tests gustatifs permettent d’évaluer la fonction gustative de l’ensemble de la bouche si on fait circuler la solution sapide dans la cavité buccale, ou celle d’aires gustatives spécifiques si on dépose des gouttelettes de substances sapides ou un papier filtre imprégné de substances sapides dans les zones cibles.
Avec l’olfaction et le sens chimique commun, le système gustatif est l’un des trois systèmes chimiosensoriels dont le rôle est de contrôler les substances nuisibles ou bénéfiques inhalées ou ingérées. Les cellules gustatives sont rapidement remplacées; elles sont innervées par quatre paires de nerfs périphériques et semblent avoir des voies centrales encéphaliques divergentes. L’appareil gustatif permet de reconnaître quatre saveurs fondamentales (sucrée, salée, amère et acide) et, peut-être, les goûts de métal et d’umami (glutamate monosodique). Les agueusies cliniquement significatives sont rares, probablement en raison de la diversité et de la surabondance de l’innervation. Les dysgueusies sont en revanche plus fréquentes et peuvent être plus pénibles. Les agents toxiques incapables de détruire le système gustatif ou d’empêcher la transduction ou la transmission des informations gustatives peuvent cependant nuire à la perception normale des saveurs. Un ou plusieurs des facteurs suivants peuvent modifier ou empêcher cette perception: transport suboptimal des substances sapides, altération de la composition de la salive, inflammation des cellules gustatives, blocage des canaux ioniques des cellules gustatives, altération de la membrane des cellules gustatives ou des protéines réceptrices, neurotoxicité périphérique ou centrale. L’appareil gustatif peut aussi être intact et fonctionner normalement, mais être soumis à des stimulations sensorielles désagréables provoquées par de faibles courants galvaniques intrabuccaux ou par la perception de médicaments, de pesticides ou d’ions métalliques intrabuccaux.
Trois systèmes sensoriels sont organisés uniquement pour enregistrer le contact avec les substances de l’environnement, l’olfaction (odorat), le goût (perception des saveurs sucrée, salée, acide et amère) et le sens chimique commun (détection des propriétés irritantes ou de l’âcreté). Ces systèmes sont dénommés «chimiosensoriels» parce qu’ils sont stimulés par des substances chimiques. Les troubles olfactifs comprennent la perte passagère ou permanente, partielle ou totale de l’odorat (hyposmie ou anosmie) et les parosmies (altération des sensations olfactives ou illusions olfactives) (Mott et Leopold, 1991; Mott, Grushka et Sessle, 1993). Quelques personnes décrivent une sensibilité accrue aux stimuli chimiques (hyperosmie) après exposition à des substances chimiques. La flaveur est la perception sensorielle résultant de l’interaction des composants odorants, sapides et irritants des aliments et des boissons, ainsi que de leur texture et de leur température. La flaveur étant due pour sa plus grande partie à l’odeur ou à l’arôme des substances ingérées, les atteintes du système olfactif sont souvent confondues avec un trouble gustatif.
Les affections chimiosensorielles sont fréquentes dans le milieu de travail et peuvent résulter de la perception de substances chimiques environnantes par un système sensoriel normal. Elles peuvent également correspondre à une atteinte de ce système, que le contact inévitable avec les substances chimiques rend particulièrement vulnérable. Dans le milieu de travail, les systèmes chimiosensoriels peuvent aussi être lésés par des traumatismes crâniens ou des agents non chimiques (rayonnements, par exemple). Les odeurs ambiantes dues à des substances polluantes peuvent aggraver des affections sous-jacentes (rhinite, asthme, par exemple), déclencher une aversion pour les odeurs ou des troubles semblables à ceux provoqués par le stress. Il a été établi que les mauvaises odeurs nuisent à l’exécution de tâches complexes (Shusterman, 1992).
Il est essentiel de détecter précocement les travailleurs atteints d’anosmie. Certaines activités telles que l’art culinaire, la fabrication des vins et celle des parfums exigent un bon odorat comme condition préalable. De nombreuses autres activités nécessitent également un odorat normal pour la protection individuelle ou pour la bonne exécution d’un travail. Par exemple, les parents ou le personnel des garderies se fient généralement à leur odorat pour déterminer si les enfants doivent être «changés». Les pompiers, quant à eux, doivent pouvoir déceler les produits chimiques et les fumées. Tout travailleur en contact avec des substances chimiques est exposé à des risques plus élevés si son odorat est défectueux.
L’olfaction est un système d’alerte précoce détectant de nombreuses substances nocives de l’environnement. La perte de ce sens peut exposer les travailleurs à ne pas se rendre compte d’une exposition dangereuse avant que la concentration de l’agent nocif ne devienne suffisamment élevée pour qu’il soit irritant, lèse les voies respiratoires ou provoque même la mort. Une détection précoce peut prévenir une atteinte supplémentaire de l’olfaction grâce à un traitement de l’inflammation et à une réduction des expositions ultérieures. Enfin, si l’anosmie est sévère et permanente, elle peut être considérée comme une invalidité imposant une reconversion professionnelle ou une réparation.
Les récepteurs olfactifs primaires sont situés sur des petites surfaces d’un tissu appelé neuroépithélium olfactif, à la partie la plus élevée des cavités nasales (Mott et Leopold, 1991). A la différence des autres systèmes sensoriels, les récepteurs sont formés par les nerfs eux-mêmes. Une portion de la cellule réceptrice olfactive atteint la surface de la muqueuse nasale et l’autre extrémité se connecte directement par un long axone à l’un de deux bulbes olfactifs du cerveau. De là, les informations se propagent vers de nombreuses autres régions du cerveau. Les substances odorantes sont des produits chimiques volatils qui doivent entrer en contact avec les récepteurs olfactifs pour induire une perception odorante. Les molécules odorantes sont captées par le mucus, où elles diffusent pour se fixer ensuite sur les cils de l’extrémité des récepteurs olfactifs primaires. Sans en connaître l’explication, on sait maintenant que l’être humain est capable de détecter plus de 10 000 substances odorantes, d’en distinguer plus de 5 000 et d’apprécier les différences d’intensité des odeurs. On a découvert récemment une famille de gènes codant pour les récepteurs des nerfs olfactifs primaires (Ressler, Sullivan et Buck, 1994). Cette découverte a permis d’étudier la façon dont les odeurs sont décelées et de décrire l’organisation du système olfactif. Chaque neurone est capable de répondre à des substances odorantes variées si elles sont fortement concentrées, mais ne répond qu’à un petit nombre si elles sont peu concentrées. Une fois stimulées, les protéines superficielles du récepteur déclenchent des processus intracellulaires traduisant les informations sensorielles en signal élec- trique (transduction). On ignore ce qui met fin au signal sensoriel, alors même que l’exposition à la substance odorante se prolonge. On a découvert des protéines solubles fixant les substances odorantes solubles, mais leur rôle n’a pas été établi. Il se peut que des protéines métabolisant les substances odorantes jouent un rôle ou que des protéines porteuses véhiculent les substances odorantes des cils olfactifs ou les conduisent vers un site de catalyse à l’intérieur des cellules olfactives.
Les parties des récepteurs olfactifs se connectant directement avec le cerveau sont de fins filaments nerveux passant à travers une lame osseuse. Cette disposition et la structure délicate de ces filaments les exposent à des lésions par cisaillement en cas de choc sur la tête. Puisque le récepteur olfactif est un nerf entrant en contact physique avec les substances odorantes et relié directement au cerveau, les substances pénétrant dans les cellules olfactives peuvent suivre les axones jusqu’au cerveau. Du fait d’une exposition continue à des agents lésant les récepteurs olfactifs, le sens de l’olfaction pourrait être perdu tôt au cours de la vie en l’absence d’une propriété essentielle: la capacité de régénération des nerfs olfactifs, qui peuvent être remplacés, à condition que la destruction n’ait pas été complète. Toutefois, si les lésions du système sont plus centrales, les nerfs ne peuvent pas être reconstitués.
Le sens chimique commun correspond à la stimulation des multiples terminaisons libres du nerf trijumeau (NC V) dans la muqueuse nasale. Il perçoit les propriétés irritantes des substances inhalées et déclenche des réflexes destinés à réduire l’exposition aux substances dangereuses, tels qu’éternuement, sécrétion de mucus et ralentissement ou même arrêt de la respiration. Plus ces signaux sont forts et plus vite on se retirera du milieu irritant. Le caractère irritant des substances est variable, mais leur odeur est généralement perçue avant que ne se produise une irritation (Ruth, 1986). Par contre, une fois l’irritation perçue, de légères augmentations de la concentration accroissent l’irritation davantage que la sensation odorante. La sensation d’irritation peut résulter d’une interaction physique ou chimique avec les récepteurs (Cometto-Muñiz et Cain, 1991). Le pouvoir d’alarme des gaz et des vapeurs semble lié à leur solubilité dans l’eau (Shusterman, 1992). Les sujets anosmiques ne détectent les substances chimiques irritantes qu’à des concentrations plus élevées, semble-t-il (Cometto-Muñiz et Cain, 1994), mais les seuils de détection n’augmentent pas avec le vieillissement (Stevens et Cain, 1986).
La perception des substances chimiques peut être modifiée par les expériences antérieures. Une tolérance se développe lorsque l’exposition diminue la réponse aux expositions ultérieures. Il y a adaptation quand des stimulations constantes ou se succédant rapidement entraînent une réponse qui va en diminuant. Par exemple, une exposition courte à des solvants réduit fortement, mais passagèrement, la capacité de les percevoir (Gagnon, Mergler et Lapare, 1994). Une adaptation peut également se produire en cas d’exposition prolongée à de faibles concentrations ou, rapidement, pour certains produits chimiques s’ils sont très concentrés. Dans ce dernier cas, il peut se produire rapidement une paralysie olfactive réversible. L’adaptation et la tolérance aux substances irritantes sont généralement moindres que celles qui concernent les odeurs. Le mélange de substances chimiques peut aussi modifier les concentrations perçues. De façon générale, quand on mélange des substances odorantes, l’intensité de l’odeur perçue est moindre que celle qui résulterait de l’addition des intensités de chacune (hypoadditivité). En revanche, l’irritation nasale montre une additivité en cas d’exposition à des substances multiples ou de répétition de la stimulation (Cometto-Muñiz et Cain, 1994). Lorsqu’un mélange contient à la fois une substance odorante et un irritant, l’odeur est toujours perçue moins intensément. En raison de la tolérance, de l’adaptation et de l’hypoadditivité, il faut éviter de se fier aux organes sensoriels pour évaluer la concentration des substances chimiques dans l’environnement.
L’olfaction est perturbée quand les substances odorantes ne peuvent plus atteindre les récepteurs olfactifs ou quand les organes olfactifs sont lésés. La congestion de la muqueuse nasale associée aux rhinites, sinusites ou polypes peut faire obstacle à la pénétration des substances odorantes. Des troubles peuvent résulter d’une inflammation des cavités nasales; d’une destruction du neuroépithélium olfactif par des agents divers; de traumatismes crâniens; de la pénétration dans le cerveau, par la voix des nerfs olfactifs, d’agents pathogènes lésant la partie olfactive du système nerveux central. Les lieux de travail contiennent en quantité variable des agents potentiellement nocifs (Amoore, 1986; Cometto-Muñiz et Cain, 1991; Shusterman, 1992; Schiffman et Nagle, 1992). Les résultats d’une enquête (National Geographic Smell Survey) portant sur 712 000 sujets indiquent que le travail en usine altère l’odorat. Les travailleurs d’usine des deux sexes ont signalé avoir des troubles de l’odorat et ont montré une olfaction diminuée dans les tests (Corwin, Loury et Gilbert, 1995). En même temps, ils ont fait état d’une exposition aux substances chimiques et de traumatismes crâniens plus fréquemment que les personnes travaillant dans un autre cadre.
Il peut être difficile d’identifier l’agent responsable en cas de trouble olfactif présumé professionnel. Les connaissances actuelles proviennent en grande partie de séries limitées et de rapports cliniques. Il faut noter que peu d’études mentionnent un examen du nez et des sinus. La plupart d’entre elles se fondent sur les antécédents olfactifs décrits par le patient plutôt que sur des tests olfactifs. Une cause supplémentaire de complications est la prévalence élevée, dans la population générale, de troubles olfactifs d’origine non professionnelle, dus le plus souvent à des infections virales, à des allergies, à des polypes nasaux, à des sinusites et à des traumatismes crâniens. Certains de ces troubles sont cependant plus fréquents dans le milieu du travail et sont traités en détail ci-dessous.
Chez les personnes présentant des troubles olfactifs, il faut commencer par rechercher la présence éventuelle de rhinite, de sinusite et de polypose. On estime, par exemple, que 20% de la population américaine souffrent d’une allergie des voies aériennes supérieures. Les expositions environnementales peuvent ne pas être en cause, mais provoquer une inflammation ou aggraver un trouble préexistant. La rhinite s’accompagne d’une anosmie en milieu professionnel (Welch, Birchall et Stafford, 1995). Certains produits chimiques, comme les isocyanates, les anhydrides d’acides, les sels de platine et les colorants réactifs (Coleman et coll., 1994), de même que les métaux (Nemery, 1990) peuvent être allergisants. De nombreux éléments d’information donnent à penser que les produits chimiques et les poussières augmentent la sensibilité aux allergènes non chimiques (Rusznak, Devalia et Davies, 1994). Les produits toxiques modifient la perméabilité de la muqueuse nasale, facilitent la pénétration des allergènes et aggravent les symptômes, ce qui rend difficile la distinction entre les rhinites allergiques et celles qui sont dues à l’exposition à des toxiques ou à des poussières. S’il existe une inflammation ou une obstruction du nez ou des sinus, le traitement peut rétablir une olfaction normale. Pour ce traitement, on peut employer les pulvérisations de corticostéroïdes, les antihistaminiques et les décongestionnants, les antibiotiques, ou recourir à l’ablation des polypes ou à la chirurgie des sinus. S’il n’existe pas d’inflammation ou d’obstruction ou si le traitement n’améliore pas l’olfaction, c’est que les tissus olfactifs ont subi des lésions irréversibles. Quelle qu’en soit la cause, le sujet doit être protégé de nouveaux contacts avec la substance responsable pour éviter de nouvelles lésions de l’appareil olfactif.
Les traumatismes crâniens peuvent affecter l’olfaction par: 1) des lésions nasales avec formation de cicatrices sur le neuroépithélium; 2) des lésions nasales avec obstruction mécanique des odeurs; 3) un cisaillement des nerfs olfactifs; et 4) une contusion ou une destruction des parties du cerveau participant à la perception des odeurs (Mott et Leopold, 1991). Dans nombre de lieux de travail, il existe un risque de traumatisme crânien que l’exposition à certains produits chimiques peut augmenter (Corwin, Loury et Gilbert, 1995).
Une anosmie se voit chez 5 à 30% des patients après un traumatisme crânien et peut exister sans autres troubles nerveux. Des obstructions du nez nuisant à l’olfaction peuvent être corrigées par la chirurgie, à moins qu’une importante cicatrisation intranasale ne se soit déjà produite. Dans les autres cas, il n’existe pas de traitement des troubles de l’olfaction résultant de traumatismes crâniens, mais une amélioration spontanée est toujours possible. On peut assister à une récupération rapide de l’olfaction dès la résorption de l’état congestif de la partie lésée. Si des terminaisons olfactives ont été coupées, elles peuvent se régénérer, mais dans ce cas la récupération est très graduelle; bien que, chez l’animal, cela puisse se produire en 60 jours, il faut attendre parfois des années chez l’humain pour observer pareille amélioration: par exemple, sept ans après le traumatisme. Les parosmies apparaissant au cours de la convalescence après un traumatisme crânien peuvent indiquer le développement de fibres olfactives nouvelles et annoncer le retour à un certain degré d’olfaction. Les parosmies survenant au moment du traumatisme, ou peu après, sont plus probablement dues à des lésions cérébrales. Ces lésions sont irréversibles et il ne faut pas s’attendre à une amélioration de l’olfaction. On trouvera plus souvent des lésions du lobe frontal, partie du cerveau essentielle pour la pensée et les émotions, dans les traumatismes crâniens avec anosmie. Les troubles de la pensée et du caractère qui en résultent peuvent sembler ténus et, pourtant, ils peuvent nuire à la vie familiale et professionnelle. C’est pourquoi il faut recourir, chez certains patients, à une véritable prise en charge.
Les agents environnementaux peuvent atteindre l’appareil olfactif par voie sanguine ou par l’inhalation d’air et peuvent provoquer des anosmies, des parosmies et des hyperosmies. Parmi les agents en cause, il faut citer les composés métalliques, les poussières de métal, les composés inorganiques non métalliques, les composés organiques, les poussières de bois et d’autres substances que l’on rencontre dans le milieu de travail, en particulier dans les processus de fabrication en métallurgie et dans d’autres industries (Amoore, 1986; Schiffman et Nagle, 1992) (voir tableau 11.6). Les lésions peuvent se produire à la suite d’expositions aiguës ou chroniques et peuvent être réversibles ou irréversibles, selon la sensibilité du sujet et l’agent en cause. Les facteurs importants sont la bioactivité, le pouvoir irritant, la durée de l’exposition, la vitesse d’élimination et une éventuelle synergie avec d’autres produits chimiques. La sensibilité du sujet varie avec son patrimoine génétique et son âge. Pour l’olfaction, il existe des différences liées au sexe, à la modulation hormonale du métabolisme des substances odorantes et aux particularités des anosmies. Le tabagisme, les allergies, l’asthme, l’état nutritionnel, les affections préexistantes (syndrome de Sjögren, par exemple), l’effort physique lors de l’exposition, le type de respiration nasale et, éventuellement, des acteurs psychosociaux interviennent dans les différences individuelles (Brooks, 1994). La résistance des tissus périphériques aux lésions et la quantité de nerfs olfactifs en état de fonctionner peuvent modifier la sensibilité. Par exemple, les expositions aiguës sévères peuvent ravager le neuroépithélium olfactif et empêcher efficacement la diffusion du toxique dans le système nerveux central. Inversement, des expositions légères prolongées peuvent permettre le maintien de tissu périphérique fonctionnel, ainsi que le passage lent, mais constant, de la substance pathogène dans le cerveau. Le cadmium, par exemple, a une demi-vie de 15 à 30 ans chez l’humain et ses effets peuvent ne se manifester que plusieurs années après l’exposition (Hastings, 1990).
|
Agents |
Trouble de l’odorat |
Référence |
|
Acétaldéhyde |
H |
2 |
|
Acétate d’éthyle |
H/A |
1 |
|
Acétate de butyle |
H/A |
1 |
|
Acétates de butyle et d’éthyle |
H ou A |
3 |
|
Acétone |
H; P |
2 |
|
Acétophénone |
Seuil olfactif tout juste normal |
2 |
|
Acide acétique |
H |
2 |
|
Acide benzoïque |
H |
2 |
|
Acide chromique |
H |
2 |
|
Acide nitrique |
H |
2 |
|
Acide sulfurique |
H |
1 ; Petersen et Gormsen, 1991 |
|
Acides (organiques et minéraux) |
H |
2 |
|
Acier (production de l’) |
Seuil olfactif tout juste normal |
2 |
|
Acrylate, métacrylate (vapeurs) |
Reconnaissance des odeurs diminuée |
1 |
|
Aimants (fabrication des) |
H |
2 |
|
Aluminium (fumées) |
H |
2 |
|
Alun |
H |
2 |
|
Ammoniaque |
H |
1 ; 2 |
|
Anginine |
H |
1 |
|
Argent (plaquage) |
Seuil olfactif inférieur à la normale |
2 |
|
Arsenic |
H |
2 |
|
Arsenite de cuivre |
H |
2 |
|
Asphalte (oxydé) |
Seuil olfactif tout juste normal |
2 |
|
Benzaldéhyde |
H |
2 |
|
Benzène |
Seuil olfactif inférieur à la moyenne |
2 |
|
Benzine |
H/A |
1 |
|
Benzol |
H/A |
1 |
|
Bois durs |
A |
2 |
|
Brome |
H |
2 |
|
Butylène glycol |
H |
2 |
|
Cadmium, composés, poussières, oxydes |
H/A |
1 ; Bar-Sela et coll., 1992; Rose, Heywood et Costanzo, 1992 |
|
Carbonyle de fer |
H |
1 |
|
Cendres (d’incinérateur) |
H |
4 |
|
Céréales |
H ou A |
4 |
|
Charbon (soute à charbon) |
H |
4 |
|
Châtaigner (poussières de bois) |
A |
2 |
|
Chaux |
H |
2 |
|
Chlore |
H |
2 |
|
Chlorométhanes |
Seuil olfactif tout juste normal |
2 |
|
Chlorovinylarsine (chlorure) |
H |
2 |
|
Chlorure d’acide |
H |
2 |
|
Chlorure d’hydrogène |
H |
2 |
|
Chromate |
Trouble de l’olfaction |
1 |
|
Chrome (fumées) |
H |
2 |
|
Chrome (sels et plaquage) |
H |
2 ; 4 |
|
Ciments |
H |
4 |
|
Coke |
H ou A |
4 |
|
Composés nitrés |
H |
2 |
|
Coton (industrie du) |
H |
4 |
|
Craie (poussières) |
H |
1 |
|
Créosote (fumées) |
Seuil olfactif anormal (test UPSIT) |
5 |
|
Cuivre (et acide sulfurique) |
Trouble de l’olfaction |
Savov, 1991 |
|
Cuivre (fumées) |
H |
2 |
|
Cyanure d’hydrogène |
A |
2 |
|
Cyanures |
H |
2 |
|
Dichromates |
H |
2 |
|
Dioxyde d’azote |
H |
2 |
|
Dioxyde de sélénium |
H |
2 |
|
Dioxyde de silicone |
H |
4 |
|
Eaux usées |
Seuil olfactif tout juste normal |
2 |
|
Epices |
H |
4 |
|
Etain (fumées) |
H |
2 |
|
Ether éthylique |
H |
2 |
|
Farine, meunerie |
H |
4 |
|
Fluor (composés) |
H |
2 |
|
Fluorure d’hydrogène |
H |
2 |
|
Fluorures |
H ou A |
3 |
|
Formaldéhyde |
H |
1; 2 ; Chia et coll., 1992 |
|
Furfural |
H |
2 |
|
Goudron de houille (fumées) |
H |
2 |
|
Halogénés (composés) |
H |
2 |
|
Huile de menthe poivrée |
H/A |
1 |
|
Huiles de coupe (usinage) |
Seuil olfactif inférieur à la moyenne |
2 |
|
Hydrazine |
H/A |
1 |
|
Imprimerie |
Seuil olfactif tout juste normal |
2 |
|
Iodoforme |
H |
2 |
|
Isocyanates |
H |
2 |
|
Lessives de soude et de potasse |
H |
2 |
|
Lin |
H |
2 |
|
Manganèse (fumées) |
H |
2 |
|
Menthe poivrée |
H/A |
3 |
|
Menthol |
H |
2 ; Naus, 1968 |
|
Mercure |
Seuil olfactif tout juste normal |
2 |
|
N-méthylformimino-méthylester |
A |
2 |
|
Monoxyde de carbone |
A |
2 |
|
Nickel (hydroxyde) |
A |
2 |
|
Nickel (plaquage) |
Seuil olfactif tout juste normal |
2 |
|
Nickel (poussières, hydroxyde, plaquage et raffinage) |
H/A |
1; 4 ; Bar-Sela et coll., 1992 |
|
Nickel (raffinage électrolytique) |
A |
2 |
|
Nitrate d’argent |
H |
2 |
|
Organophosphorés |
Odeur d’ail; H ou A |
3; 5 |
|
Osmium (tétroxyde) |
H |
2 |
|
Oxyde d’éthylène |
H |
Gosselin, Smith et Hodge, 1984 |
|
Ozone |
H temporaire |
3 |
|
Papier (usine d’emballage) |
H éventuelle |
4 |
|
Paprika |
H |
2 |
|
Parfums |
Limite inférieure à la moyenne |
2 |
|
Parfums (concentrés) |
H |
2 |
|
Pavinol (couture) |
Seuil olfactif tout juste normal |
2 |
|
Peintures (à base de solvants) |
H ou A |
Wieslander, Norbäck et Edling, 1994 |
|
Peintures (au plomb) |
Seuil olfactif tout juste normal |
2 |
|
Pentachlorophénol |
A |
2 |
|
Pesticides |
H ou A |
5 |
|
Pétrole |
H ou A |
3 |
|
Phénylènediamine |
H |
2 |
|
Phosgène |
H |
2 |
|
Phosphore(oxychlorure) |
H ou A |
1 |
|
Plomb |
H |
4 |
|
Poivre et créosol(mélange de) |
H/A |
1 |
|
Potasse |
H |
1 |
|
Poudre noire |
H |
2 |
|
Sélénium (composésolatils) |
H |
2 |
|
Séléniure d’hydrogène |
H/A |
1 |
|
Sulfure de carbone |
H/A |
1 |
|
Sulfure d’hydrogène |
H ou A |
5 ; Guidotti, 1994 |
|
Sels de chrome |
A |
2 |
|
Silice |
H |
4 |
|
Solvants |
H; P; seuil olfactif tout juste normal |
Ahlström, Berglund et Berglund, 1986; Schwartz et coll., 1991; Bolla et coll., 1995 |
|
Solvants à based’hydrocarbures aromatiques (toluène, xylène, éthylbenzène) |
Seuil olfactif diminué (test UPSIT); H |
5 ; Hotz et coll., 1992 |
|
Soufre (composés) |
H |
2 |
|
Soufre (dioxyde) |
H |
2 |
|
Tabac |
H |
2; 4 |
|
Tabagisme |
Reconnaissance des odeurs diminuée |
1 |
|
Tannage |
H |
2 |
|
Tétrabromoéthane |
P; H ou A |
5 |
|
Tétrachloroéthane |
H |
2 |
|
Tétrachlorure de carbone |
H |
2 |
|
Trichloroéthane |
H |
2 |
|
Trichloroéthylène |
H/A |
2 |
|
Vanadium (fumées) |
H |
2 |
|
Vernis |
H |
2 |
|
Vulcanisation du caoutchouc |
H |
2 |
|
Zinc (fumées, chromate) et production |
Seuil olfactif tout juste normal |
2 |
H = hyposmie; A = anosmie; P = parosmie; UPSIT = University of Pennsylvania Smell Identification Test (test normalisé d'olfactométrie).
1 Mott et Leopold, 1991. 2 Amoore, 1986. 3 Schiffman er Nagle, 1992. 4 Naus, 1985. 5 Callender et coll., 1993.
Les troubles spécifiques de l'odorat sont indiqués dans les articles cités.
Dix mille à 20 000 litres d’air passent en un jour à travers les cavités nasales; ils contiennent en quantité variable des agents pouvant être nocifs. Les voies aériennes supérieures absorbent ou épurent presque totalement les gaz solubles ou fortement réactifs et les particules de plus de 2 mm (Evans et Hastings, 1992). Il existe heureusement un certain nombre de mécanismes protecteurs. La muqueuse nasale est très vascularisée, riche en nerfs, en cellules spécialisées munies de cils capables de mouvements synchronisés et de glandes produisant du mucus. Les mécanismes de défense comprennent la filtration et l’élimination des particules, l’épuration des gaz hydrosolubles et la détection des agents nocifs par l’olfaction, ainsi que la détection des irritants par la muqueuse qui peuvent alerter le sujet et le faire se soustraire à une exposition supplémentaire (Witek, 1993). Les produits chimiques en faible quantité sont absorbés par la couche de mucus, entraînés par le battement des cils (épuration mucociliaire) et sont ensuite déglutis. Les produits chimiques peuvent se lier à des protéines et être rapidement transformés en produits moins dangereux. La muqueuse nasale et les tissus olfactifs contiennent de nombreuses enzymes (Bonnefoi, Monticello et Morgan, 1991; Schiffman et Nagle, 1992; Evans et coll., 1995). Le neuroépithélium olfactif contient, par exemple, du cytochrome P 450, qui joue un rôle important dans la détoxication des substances étrangères (Gresham, Molgaard et Smith, 1993). Ce système peut protéger les cellules olfactives primaires et détoxiquer des substances qui, en l’absence de ces mécanismes, gagneraient le système nerveux central par les nerfs olfactifs. On a constaté aussi qu’un neuroépithélium olfactif intact peut empêcher la pénétration de certains organismes, tels que Cryptococcus (Lima et Vital, 1994). Il peut aussi exister, dans les bulbes olfactifs, des mécanismes protecteurs empêchant le transport en profondeur des substances toxiques. Ainsi, il a été démontré que les bulbes olfactifs contiennent des métallothionéines, protéines ayant un effet de protection contre les toxines (Choudhuri et coll., 1995).
Si les défenses sont dépassées, un cercle vicieux pathogène peut s’établir. La perte de l’olfaction empêche une détection rapide du risque et permet une prolongation de l’exposition. L’augmentation de la circulation sanguine nasale et de la perméabilité des vaisseaux provoque un œdème faisant obstacle à la pénétration des substances odorantes. La fonction ciliaire nécessaire à l’épuration mucociliaire et à une olfaction normale peut être altérée. La diminution de l’épuration augmente la durée du contact des agents pathogènes avec la muqueuse nasale. L’absorption des substances odorantes ou irritantes est modifiée par l’altération du mucus nasal. Les substances toxiques ne pouvant plus être suffisamment métabolisées, il en résulte des lésions de la muqueuse avec une augmentation de l’absorption des toxiques et, éventuellement, une toxicité systémique accrue. L’épithélium lésé est plus vulnérable aux expositions ultérieures. Les effets directs sur les récepteurs olfactifs sont également augmentés. Les substances toxiques peuvent modifier la vitesse de renouvellement des récepteurs olfactifs (normalement 30 à 60 jours), léser leur membrane ou modifier leur environnement externe ou interne. Malgré une régénération possible, les tissus olfactifs lésés peuvent subir une atrophie définitive ou être remplacés par des tissus non sensoriels.
Les nerfs olfactifs fournissent un accès direct au système nerveux central et peuvent être une voie de pénétration pour des éléments exogènes divers, dont des virus, des solvants et certains métaux (Evans et Hastings, 1992). Ce mécanisme peut contribuer à certaines démences en relation avec l’olfaction (Monteagudo, Cassidy et Folb, 1989; Bonnefoi, Monticello et Morgan, 1991), par transport d’aluminium vers les centres nerveux, par exemple. Du cadmium introduit par voie intranasale, mais non intrapéritonéale ni intratrachéale, peut être mis en évidence dans le bulbe olfactif homolatéral (Evans et Hastings, 1992). Certaines constatations portent à penser également que des substances peuvent être captées par le tissu olfactif, quel que soit le site d’exposition initial (systémique ou par inhalation). On a, par exemple, trouvé de fortes concentrations de mercure dans les voies olfactives du cerveau des sujets porteurs d’amalgames dentaires (Siblerud, 1990). L’électroencéphalographie montre la sensibilité des bulbes olfactifs à de nombreux polluants atmosphériques, tels que l’acétone, le benzène, l’ammoniaque, le formol et l’ozone (Bokina et coll., 1976). Par suite des effets de certains solvants à base d’hydrocarbures sur le système nerveux central, des sujets exposés peuvent ne pas reconnaître le danger et ne pas s’en éloigner, prolongeant ainsi l’exposition. A l’aide d’un scanner SPECT évaluant l’irrigation sanguine régionale du cerveau, Callender et coll. (1993) ont constaté des anomalies chez 94% des sujets exposés à des neurotoxiques et présentant, avec une grande fréquence, des troubles de l’identification des odeurs. La localisation des anomalies mises en évidence par la tomographie est un argument en faveur du transport des substances toxiques le long des voies olfactives.
La localisation des lésions de l’appareil olfactif varie selon les agents en cause (Cometto-Muñiz et Cain, 1991). Par exemple, l’acrylate d’éthyle et le nitroéthane lèsent sélectivement le tissu olfactif, alors que le tissu respiratoire nasal est préservé (Miller et coll., 1985). Le formaldéhyde modifie la consistance du mucus nasal et l’acide sulfurique son pH. De nombreux gaz, les sels de cadmium, la diméthylamine et la fumée de tabac dégradent la fonction ciliaire. L’éther de diéthyle provoque la fuite de certaines molécules des jonctions intercellulaires (Schiffman et Nagle, 1992). Les solvants comme le toluène, le styrène et le xylène modifient les cils olfactifs; ils semblent également être conduits jusqu’au cerveau par les récepteurs olfactifs (Hotz et coll., 1992). Le sulfure d’hydrogène est non seulement irritant pour la muqueuse, mais aussi fortement neurotoxique: il prive les cellules d’oxygène et provoque une paralysie rapide des nerfs olfactifs (Guidotti, 1994). Le nickel lèse directement les membranes cellulaires et interfère également avec les enzymes protectrices (Evans et coll., 1995). On pense que les solutions de cuivre interfèrent directement dans différentes étapes de la transduction au niveau des récepteurs olfactifs (Winberg et coll., 1992). Le chlorure de mercure se fixe sélectivement sur le tissu olfactif et peut interférer avec le fonctionnement des neurones en provoquant des anomalies au niveau des neurotransmetteurs (Lakshmana, Desiraju et Raju, 1993). Les pesticides injectés dans le sang sont captés par la muqueuse nasale (Brittebo, Hogman et Brandt, 1987) et peuvent provoquer une congestion nasale. L’odeur alliacée perçue avec les pesticides organophosphorés n’est pas due à une lésion des tissus, mais à la perception du butylmercaptan.
Si le tabagisme peut provoquer une inflammation de la muqueuse nasale et diminuer l’odorat, il peut également protéger contre d’autres agents pathogènes. Les produits chimiques contenus dans la fumée peuvent déclencher le système enzymatique du cytochrome P450 microsomal (Gresham, Molgaard et Smith, 1993) et accélérer ainsi le métabolisme des produits chimiques toxiques avant qu’ils ne lèsent le neuroépithélium olfactif. Inversement, certains médicaments, comme les antidépresseurs tricycliques et les antipaludéens, peuvent inhiber le cytochrome P450.
L’anosmie provoquée par les poussières de bois et de panneaux de fibres ou particules de bois (Innocenti et coll., 1985; Holm-ström, Rosén et Wilhelmsson, 1991; Mott et Leopold, 1991) peut être due à des mécanismes variés. Des rhinites allergiques et non allergiques peuvent provoquer une obstruction faisant obstacle aux substances odorantes ou une inflammation. Les lésions de la muqueuse peuvent être sévères et on a observé des dysplasies (Boysen et Solberg, 1982); il peut en résulter un adénocarcinome, en particulier au niveau de la base de l’ethmoïde, près du neuroépithélium olfactif. Les carcinomes provoqués par les bois durs peuvent être liés à leur forte teneur en tanin (Innocenti et coll., 1985). Une incapacité d’éliminer efficacement le mucus nasal peut s’accompagner d’une augmentation de la fréquence des rhumes (Andersen, Andersen et Solgaard, 1977); les infections virales qui en résultent peuvent léser davantage le système olfactif. L’anosmie peut aussi être due aux produits chimiques utilisés dans le travail du bois, comme les vernis et les colorants. Les panneaux de fibres de densité moyenne contiennent du formaldéhyde, connu pour irriter le tissu respiratoire: il altère l’épuration muco-ciliaire, provoque une anosmie et est associé à une incidence élevée de cancers de la bouche, du nez et du pharynx (Council on Scientific Affairs, 1989); tous ces mécanismes peuvent contribuer à expliquer les anosmies dues au formaldéhyde.
La radiothérapie peut être responsable de troubles de l’olfaction (Mott et Leopold, 1991), mais on dispose de peu d’informations sur les expositions professionnelles. Une vulnérabilité des cellules réceptrices olfactives en tant que tissu à régénération rapide est probable. Les souris exposées à des rayonnements pendant un vol spatial ont présenté des anomalies du tissu olfactif, la muqueuse nasale restant par ailleurs normale (Schiffman et Nagle, 1992).
Après des expositions à des produits chimiques, certaines personnes signalent une sensibilité augmentée aux substances odorantes. On qualifie de «syndrome d’intolérance aux produits chimiques» ou de «maladie environnementale» les troubles caractérisés par une hypersensibilité à divers produits chimiques de l’environnement, souvent à faible concentration (Cullen, 1987; Miller, 1992; Bell, 1994). Cependant, on n’a pas mis en évidence un abaissement des seuils de perception des substances odorantes.
Le vieillissement et le tabagisme diminuent la sensibilité olfactive. Les infections virales des voies respiratoires supérieures, les affections idiopathiques (non connues), les traumatismes crâniens et les affections du nez et des sinus semblent être les quatre causes principales des problèmes olfactifs aux Etats-Unis (Mott et Leopold, 1991); il faut les prendre en considération dans le diagnostic différentiel des troubles présumés d’origine professionnelle. Les incapacités congénitales à percevoir certaines odeurs sont fréquentes. Jusqu’à 40 à 50% de la population ne peut pas déceler l’androstérone, stéroïde présent dans la sueur.
La psychophysique mesure la réponse à l’application d’un stimulus sensoriel. On utilise fréquemment des tests qui déterminent la concentration minimale pouvant être perçue fiablement: ce sont les tests de seuil. On peut obtenir des seuils distincts pour la détection et l’identification des substances odorantes. Les tests supraliminaires évaluent la capacité du système olfactif à des niveaux supérieurs au seuil et peuvent aussi fournir des informations utiles. Les tests de discrimination, visant à déceler les différences entre substances, peuvent révéler des modifications subtiles des capacités sensorielles. Chez un même individu, les tests d’identification peuvent donner des résultats différents de ceux des tests de seuil. Par exemple, une personne présentant une lésion du système nerveux central peut être capable de détecter des substances odorantes aux niveaux seuils habituels, tout en étant incapable d’identifier des substances odorantes courantes.
Les cavités nasales sont traversées par 10 000 à 20 000 litres d’air par jour et peuvent être plus ou moins exposées à des matières éventuellement dangereuses. L’appareil olfactif est particulièrement vulnérable en raison du contact direct avec les produits chimiques volatils nécessaire pour la perception olfactive. L’anosmie, la tolérance et l’adaptation empêchent de reconnaître la proximité de produits chimiques dangereux et peuvent être responsables de lésions locales ou d’une intoxication systémique. La détection précoce des troubles olfactifs peut inciter à des mesures de protection et à la mise en place d’un traitement adapté, et donc éviter des lésions supplémentaires. Les troubles de l’olfaction d’origine professionnelle peuvent être une hyposmie ou une anosmie passagères ou permanentes ou une dysosmie. Les causes identifiables à prendre en considération dans le cadre professionnel comprennent les rhinites, les sinusites, les traumatismes crâniens, les irradiations et les lésions tissulaires provoquées par les composés métalliques, les poussières de métal, les composés inorganiques non métalliques, les composés organiques, les poussières de bois et les substances présentes dans la métallurgie et dans d’autres industries. Les substances n’agissent pas toutes au niveau du même site du système olfactif. Des mécanismes efficaces de captage, d’élimination et de détoxication des substances étrangères servent à protéger l’olfaction et empêchent le passage des agents pathogènes des cavités nasales vers le cerveau. Si ces mécanismes de défense sont dépassés, un cercle vicieux de lésions peut s’installer, aboutissant à une aggravation des troubles, à une extension des lésions et à la transformation de troubles temporaires réversibles en affections permanentes.
La sensibilité cutanée partage les caractéristiques principales de tous les sens fondamentaux. Les propriétés externes telles que les couleurs, les sons et les vibrations sont perçues par des terminaisons nerveuses spécialisées appelées récepteurs, qui les transforment en influx nerveux. Ces signaux sont ensuite transmis au système nerveux central, où ils servent à l’appréhension du monde extérieur.
Il est utile de noter trois points essentiels au sujet de ces processus. En premier lieu, l’énergie et les variations de niveau de l’énergie ne peuvent être perçues que par un organe sensoriel capable de détecter le type particulier d’énergie en cause (c’est pourquoi les micro-ondes, les rayons X et les ultraviolets sont dangereux; nous ne sommes pas équipés pour les détecter, même lorsqu’ils atteignent des niveaux létaux). En deuxième lieu, nos perceptions ne peuvent que refléter imparfaitement la réalité, car notre système nerveux central ne reconstruit qu’une image incomplète à partir des signaux transmis par les récepteurs sensoriels. Enfin, nos systèmes sensoriels nous fournissent des informations plus exactes sur les modifications de notre environnement que sur des conditions statiques. Nous sommes bien pourvus en récepteurs sensoriels sensibles aux lumières papillotantes ou aux faibles variations de température provoquées par une brise légère, mais nous sommes moins bien équipés pour recevoir des informations sur une température stable ou sur une pression constante sur la peau.
Habituellement, on classe la sensibilité tactile en superficielle et profonde. Alors que la sensibilité profonde met en jeu des récepteurs situés dans les muscles, les tendons, les articulations et le périoste, la sensibilité superficielle qui nous intéresse ici traite les informations reçues par les récepteurs cutanés: plus précisément, les différents types de récepteurs qui sont situés à la jonction ou près de la jonction du derme et de l’épiderme.
Tous les nerfs sensitifs reliant les récepteurs cutanés au système nerveux central ont à peu près la même structure. Le volumineux corps cellulaire du neurone se trouve à l’intérieur d’un amas d’autres corps cellulaires neuronaux, appelé ganglion, situé près de la moelle épinière et relié à elle par un étroit filet du neurone que l’on appelle son axone. La plupart des cellules nerveuses ou neurones prenant leur origine dans la moelle épinière envoient des axones vers les os, les muscles, les articulations ou, dans le cas de la sensibilité cutanée, vers la peau. Tout comme un fil électrique isolé, chaque axone est couvert sur son trajet et à sa terminaison par une couche de cellules protectrices appelées cellules de Schwann. Ces cellules produisent une substance, la myéline, qui forme une gaine autour de l’axone. La myéline présente de fines interruptions espacées, appelées nodules de Ranvier. Enfin, à l’extrémité de l’axone, on trouve les éléments spécialisés dans la perception et la transmission des informations relatives au milieu extérieur: les récepteurs sensoriels (Mountcastle, 1974).
Comme tous les récepteurs sensoriels, les différents types de récepteurs cutanés sont définis à la fois par leur anatomie et par le type de signaux électriques qu’ils transmettent aux fibres nerveuses. Les récepteurs ayant une structure distincte portent généralement le nom de celui qui les a découverts. Les types de récepteurs sensoriels que l’on trouve dans la peau sont relativement peu nombreux et on peut les diviser en trois groupes: les mécanorécepteurs, les thermorécepteurs et les nocicepteurs.
Tous ces récepteurs ne peuvent transmettre une information relative à un stimulus particulier qu’après l’avoir codée en un langage neuro-électrochimique. Ce codage utilise des types et des fréquences variés d’influx nerveux que les chercheurs commencent tout juste à déchiffrer. En fait, un secteur important de la recherche en neurophysiologie se consacre entièrement à l’étude des récepteurs sensoriels et à la façon dont ils traduisent des états énergétiques de l’environnement en codes transmis par les fibres nerveuses afférentes vers les centres nerveux, c’est-à-dire conduisant les signaux vers le système nerveux central.
On peut subdiviser les messages produits par les récepteurs d’après la réponse à une stimulation constante prolongée: les récepteurs à adaptation lente envoient des influx électrochimiques au système nerveux central tant que dure le stimulus, alors que les récepteurs à adaptation rapide réduisent progressivement leurs décharges face à un stimulus durable jusqu’à un niveau de base peu élevé ou à un arrêt complet, cessant ainsi d’informer le système nerveux central sur la persistance du stimulus.
Les diverses sensations de douleur, de chaleur, de froid, de pression et de vibration sont ainsi produites par des types différents de récepteurs sensoriels et de fibres nerveuses associées. On parle par exemple de «frémissement» et de «vibration» pour distinguer deux sensations vibratoires légèrement différentes codées par des types différents de récepteurs sensibles aux vibrations (Mountcastle et coll., 1967). Les trois types importants de sensation douloureuse, connus sous les appellations de piqûre, de brûlure et de douleur sourde, sont associés à des types différents de fibres afférentes nociceptrices. Cela ne signifie pas qu’une sensation spécifique ne met nécessairement en jeu qu’un seul type de récepteur. Plusieurs types de récepteurs peuvent contribuer à une sensation donnée et, de fait, les sensations peuvent varier selon la contribution relative des différents types de récepteurs (Sinclair, 1981).
Le résumé qui précède se base sur l’hypothèse de la spécificité de la fonction sensorielle cutanée, formulée pour la première fois en 1906 par von Frey, médecin allemand. Bien qu’au moins deux autres théories tout aussi en vogue, voire plus, aient été proposées au cours du dernier siècle, c’est l’hypothèse de von Frey que confirme aujourd’hui l’expérience.
Dans les mains, des fibres myélinisées relativement volumineuses (de 5 à 15 µm de diamètre) émergent d’un réseau de nerfs sous-cutanés, appelé plexus sous-papillaire, et forment une nuée de terminaisons à la jonction du derme et de l’épiderme (voir figure 11.19). Dans la peau pileuse, les terminaisons nerveuses aboutissent dans des structures superficielles visibles, appelées dômes du toucher; dans la peau glabre, les terminaisons nerveuses se trouvent à la base des crêtes de la peau (telles que celles formant les dermatoglyphes ou empreintes digitales). Dans le dôme du toucher, chaque terminaison nerveuse, ou neurite, est enfermée dans une cellule épithéliale spéciale, appelée cellule de Merkel (voir figures 11.20 et 11.21.
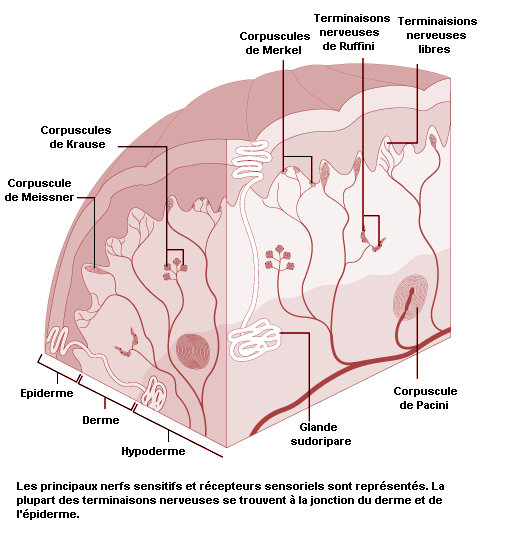
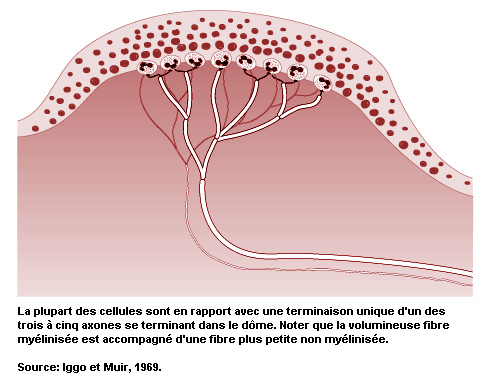
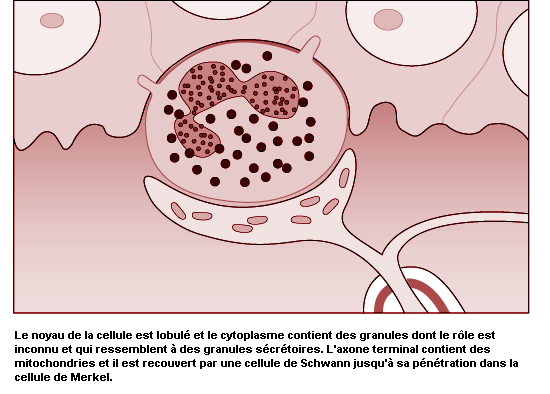
La cellule de Merkel transforme l’énergie mécanique en influx nerveux. On sait peu de choses sur le rôle de la cellule ou sur le mécanisme de transduction, mais elle est reconnue comme étant un récepteur à adaptation lente. Cela signifie qu’une pression sur un dôme du toucher contenant des cellules de Merkel provoque une production d’influx nerveux pendant toute la durée du stimulus. La fréquence de ces influx est proportionnelle à l’intensité du stimulus et elle informe ainsi le cerveau de la durée et de l’importance de la pression sur la peau.
Comme la cellule de Merkel, un deuxième type de récepteur cutané à adaptation lente signale l’intensité et la durée d’une pression continue sur la peau. Ce récepteur, dit récepteur de Ruffini, visible seulement au microscope, est formé d’un groupe de neurites émergeant d’une fibre myélinisée et entouré d’une capsule de cellules conjonctives. La capsule contient des fibres qui transmettent apparemment les déformations de la peau aux neurites, ceux-ci produisant à leur tour des messages transmis au système nerveux central par les voies nerveuses. La pression sur la peau provoque une décharge soutenue d’influx nerveux, comme pour les cellules de Merkel, la fréquence des influx étant proportionnelle à l’intensité du stimulus.
Malgré ces similitudes, il existe une différence notable entre les cellules de Merkel et les récepteurs de Ruffini. Alors que la stimulation des récepteurs de Ruffini provoque une sensation, la stimulation des dômes du toucher contenant des cellules de Merkel ne produit pas de sensation consciente; ainsi, les dômes du toucher sont des récepteurs qui demeurent mystérieux, car leur rôle réel dans la fonction nerveuse reste inconnu. On pense donc que les récepteurs de Ruffini sont les seuls récepteurs capables de produire les signaux nerveux nécessaires pour susciter la sensation de pression ou de toucher constant. De plus, on a montré que les récepteurs de Ruffini à adaptation lente expliquent l’aptitude de l’homme à évaluer les pressions exercées sur la peau selon une échelle d’intensité.
A la différence des mécanorécepteurs à adaptation lente, les récepteurs à adaptation rapide restent silencieux lorsque la peau est déformée de façon durable. Toutefois, ils sont bien adaptés à la détection des vibrations et des mouvements de la peau. Il existe deux types de récepteurs associés aux poils ou formant des terminaisons corpusculaires dans la peau glabre.
Un poil est généralement entouré d’un réseau de terminaisons nerveuses, ramifications de cinq à neuf volumineux axones myélinisés (voir figure 11.22). Chez les primates, ces terminaisons prennent trois formes: lancéolée, fusiforme et papillaire. Toutes sont à adaptation rapide, si bien qu’un déplacement durable du poil ne produit un influx qu’au moment où le poil bouge. Ainsi, ces récepteurs ont une excellente sensibilité aux stimulations dues au mouvement ou aux vibrations, mais ne fournissent que peu ou pas d’informations sur la pression.
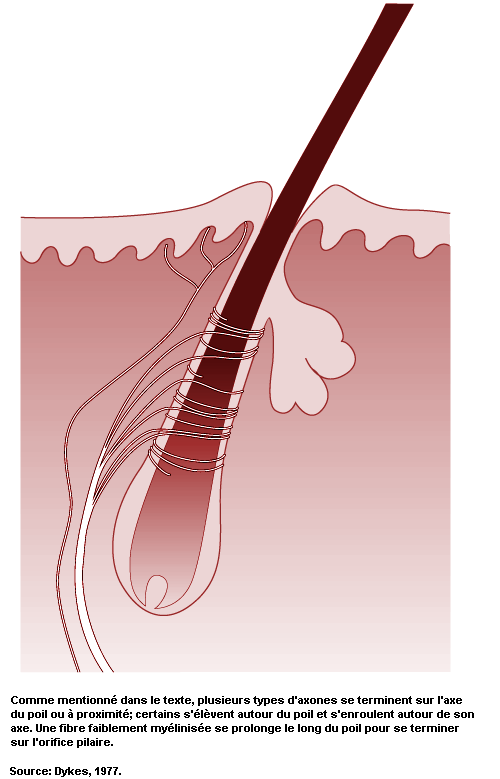
Les terminaisons lancéolées naissent de fibres fortement myélinisées formant un réseau autour du poil. Les neurites terminaux perdent leur couverture de cellules de Schwann et se fraient un chemin entre les cellules de la base du poil.
Les terminaisons fusiformes formées par des neurites entourés de cellules de Schwann s’élèvent sur la partie inclinée de l’axe du poil et se terminent en formant un amas semi-circulaire juste au-dessous d’une glande sébacée. Se terminant librement autour de l’orifice pilaire au lieu de se terminer sur l’axe du poil, les terminaisons papillaires diffèrent des terminaisons fusiformes.
Il existe sans doute des différences fonctionnelles entre les divers types de récepteurs que l’on trouve sur les poils. Cette présomption se fonde, d’une part, sur les manières différentes qu’a le nerf de se fixer à la base du poil et, d’autre part, sur les différences de diamètre des axones, puisque des axones de diamètres différents conduisent à des relais centraux différents. Les fonctions des récepteurs de la peau poilue restent un sujet de recherche.
La corrélation entre la structure anatomique du récepteur et le signal nerveux qu’il produit est la plus marquée pour les récepteurs volumineux et facilement manipulables à terminaisons nerveuses corpusculaires ou encapsulées. On connaît particulière- ment bien les corpuscules de Pacini et de Meissner, qui sont sensibles aux vibrations, comme les terminaisons nerveuses associées aux poils précédemment décrites.
Les corpuscules de Pacini ont une taille suffisante pour être vus à l’œil nu, ce qui rend facile leur association à une réponse nerveuse spécifique. Situés dans le derme, généralement autour des tendons et des articulations, ce sont des formations ressemblant à un oignon et mesurant 0,5 × 1,0 mm. Ils sont alimentés par l’une des fibres afférentes les plus volumineuses du corps, d’un diamètre de 8 à 13 µm et ayant une vitesse de conduction de 50 à 80 m par seconde. Leur structure, abondamment étudiée par microscopie optique et électronique, est bien connue.
Le principal composant du corpuscule de Pacini est une coque externe formée de cellules délimitant des espaces remplis de liquide. Cette coque externe est elle-même entourée d’une capsule traversée par un canal central et un réseau capillaire. Une fibre myélinisée unique de 7 à 11 µm de diamètre s’engage dans le canal et forme une longue terminaison non myélinisée qui s’enfonce profondément dans le centre du corpuscule de Pacini. L’axone terminal est elliptique, avec des prolongements ramifiés.
Le corpuscule de Pacini est un récepteur à adaptation rapide. Soumis à une pression prolongée, il ne produit un influx qu’au début et à la fin de la stimulation. Il répond aux vibrations de fréquence élevée (80 à 400 Hz) et sa sensibilité est maximale autour de 250 Hz. Ce récepteur répond souvent aux vibrations transmises le long des os et des tendons et son extrême sensibilité lui permet d’être activé par un simple souffle sur la main (Martin, 1985). Outre le corpuscule de Pacini, la peau glabre possède un autre récepteur à adaptation rapide. Beaucoup de chercheurs pensent qu’il s’agit du corpuscule de Meissner situé dans les papilles du derme de la peau. Le corpuscule de Meissner est sensible aux vibrations de basse fréquence (2 à 40 Hz); il est formé par les terminaisons d’une fibre myélinisée de taille moyenne, entourées d’une ou de plusieurs couches de cellules qui semblent être des cellules de Schwann modifiées, appelées cellules laminaires. Les neurites et les cellules laminaires du récepteur peuvent se connecter à une cellule basale de l’épiderme (voir figure 11.23).
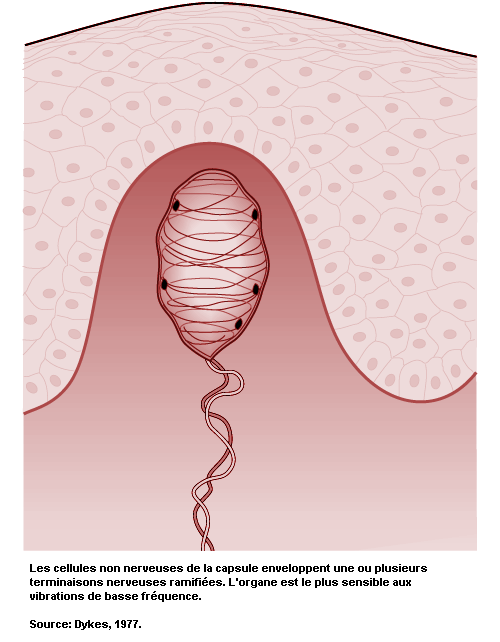
Si on anesthésie sélectivement le corpuscule de Meissner par injection d’un anesthésique local à travers la peau, les sensations de frémissement et de vibration disparaissent. Cela donne à penser que les corpuscules de Meissner sont le complément fonctionnel des corpuscules de Pacini, sensibles aux fréquences élevées. Ensemble, ces deux types de récepteurs fournissent les signaux nerveux expliquant la sensibilité de l’homme à toute une gamme de vibrations (Mountcastle et coll., 1967).
On trouve dans le derme beaucoup de fibres myélinisées et non myélinisées que l’on ne peut pas encore identifier. Un grand nombre ne fait que passer en direction de la peau, des muscles ou du périoste, tandis que d’autres (myélinisées ou non) semblent se terminer dans le derme. A quelques exceptions près, comme les corpuscules de Pacini, la plupart des fibres du derme semblent se terminer de façon mal définie ou simplement sous forme de terminaisons libres.
Des études anatomiques complémentaires sont nécessaires pour différencier ces terminaisons mal définies, mais les études physiologiques ont clairement montré que ces fibres codent pour de nombreux phénomènes extérieurs. Par exemple, les terminaisons libres situées à la jonction du derme et de l’épiderme sont responsables de la perception des stimulations externes, qui sont interprétées comme chaleur, froid, douleur, démangeaison et cha- touillement. On ne sait pas encore quels sont les types de petites fibres qui transmettent les différentes sensations.
La ressemblance anatomique apparente de ces terminaisons nerveuses libres tient probablement à l’insuffisance des techniques d’étude, étant donné que peu à peu des différences structurales entre terminaisons nerveuses libres sont mises au jour. Par exemple, dans la peau glabre, on a distingué deux types différents de terminaisons nerveuses libres, les unes courtes et épaisses, les autres longues et minces. Les études de la peau poilue de l’humain ont mis en évidence des terminaisons nerveuses reconnaissables à l’histochimie, se terminant à la jonction du derme et de l’épiderme — les terminaisons pénicillées et papillaires. Les premières naissent de fibres non myélinisées et forment un réseau; les autres, au contraire, naissent de fibres myélinisées et se terminent autour des orifices pilaires, comme précédemment indiqué. A ces différences morphologiques correspondent probablement des différences fonctionnelles.
Il n’est pas encore possible d’attribuer des fonctions spécifiques aux différentes entités structurales, mais les expériences de physiologie font clairement apparaître qu’il existe des catégories fonctionnellement différentes de terminaisons nerveuses libres. On a constaté qu’une petite fibre myélinisée répond au froid chez l’homme. Une fibre non myélinisée donnant des terminaisons nerveuses libres répond à la chaleur. On ignore comment un type de terminaisons nerveuses libres répond sélectivement à une diminution de température, alors qu’une élévation de la température de la peau induit un signal de chaleur dans un autre type. Des études ont montré que l’activation d’une petite fibre donnant des terminaisons nerveuses libres provoque une sensation de démangeaison ou de chatouillement, alors que l’on pense qu’il existe deux catégories de petites fibres spécifiquement sensibles aux stimuli douloureux mécaniques et chimiques ou aux stimuli thermiques constituant la base nerveuse des sensations douloureuses de piqûre et de brûlure (Keele, 1964).
La corrélation certaine entre anatomie et rôle physiologique doit attendre que soient mises au point des techniques plus perfectionnées. C’est là l’un des principaux obstacles au traitement des troubles tels que les causalgies, les paresthésies et les hyperpathies, qui continuent à poser des problèmes aux médecins.
Les nerfs peuvent être moteurs ou sensitifs. Les lésions des nerfs périphériques résultent généralement d’un écrasement ou d’un sectionnement et elles peuvent affecter la motricité ou la sensibilité, selon le type de fibres du nerf en cause. Certaines manifestations de la perte de motricité peuvent être mal interprétées ou passer inaperçues, car elles affectent non pas les muscles, mais le contrôle végétatif des vaisseaux, la régulation thermique, les caractères et l’épaisseur de l’épiderme et l’état des mécanorécepteurs de la peau. On ne traitera pas ici de la perte de l’innervation motrice, ni de celle de l’innervation assurant les sensibilités autres que la sensibilité cutanée.
La perte de l’innervation sensitive de la peau prédispose à d’autres lésions, en laissant une partie de peau insensible et incapable de signaler les stimulations potentiellement pathogènes. Cette peau cicatrise alors lentement, cela étant dû en partie, semble-t-il, à la perte de la régulation thermique et nutritionnelle (indispensable à la cicatrisation) résultant de l’anesthésie de l’innervation autonome.
Au bout de plusieurs semaines, les récepteurs sensoriels cutanés dénervés s’atrophient, ce qui se constate facilement sur les volumineux récepteurs encapsulés, tels que les corpuscules de Pacini et de Meissner. Si les axones peuvent se régénérer, une récupération fonctionnelle peut se produire, mais la qualité de la fonction récupérée dépend de la nature de la lésion initiale et de la durée de la dénervation (McKinnon et Dellon, 1988).
Après écrasement, la récupération physique et fonctionnelle est plus rapide et plus complète qu’après la section d’un nerf. On peut expliquer ce pronostic favorable de deux manières: d’une part, dans l’écrasement, un plus grand nombre d’axones peuvent rétablir le contact avec la peau; d’autre part, on sait que les axones sont guidés dans leur retour vers leur destination d’origine par les cellules de Schwann et les membranes basales. Or, ces structures restent intactes dans un écrasement, alors qu’après une section, les axones peuvent atteindre de mauvaises régions de la peau en empruntant les mauvaises gaines de Schwann. Il en résulte alors la transmission au cortex somato-sensoriel d’informations spatiales erronées. Dans les deux cas, cependant, les axones régénérés semblent capables de rejoindre le même type de récepteurs que celui qu’ils servaient à l’origine.
La réinnervation des récepteurs cutanés est progressive. Lorsque l’axone en développement atteint la peau, les zones de perception sont plus petites que la normale et le seuil de perception plus élevé. Les champs de réception s’étendent avec le temps et fusionnent progressivement en champs plus étendus. La sensibilité aux stimulations mécaniques augmente et se rapproche souvent de celle des récepteurs normaux de ce type. Les études utilisant des stimulations par pression, pression avec déplacement et vibrations ont montré que les modalités sensorielles attribuées à des types différents de récepteurs réapparaissent à des vitesses différentes dans les zones désensibilisées.
Observée au microscope, la peau glabre dénervée apparaît amincie, avec des crêtes épidermiques moins saillantes et un plus petit nombre de couches de cellules. Cela confirme que les nerfs exercent un rôle trophique sur la peau. Peu après le rétablissement de l’innervation, les crêtes dermiques se développent, l’épiderme devient plus épais et on peut voir des axones traverser la membrane basale. Après le retour de l’axone à un corpuscule de Meissner, la taille de celui-ci commence à augmenter et, d’atrophié et aplati qu’il était, il reprend sa forme d’origine. Si la dénervation a été prolongée, un nouveau corpuscule peut se former à côté de l’ancien corpuscule atrophié, lequel reste dénervé (Dellon, 1981).
Comme on le voit, la compréhension des conséquences des lésions des nerfs périphériques nécessite la connaissance de leur fonctionnement normal et des degrés de récupération fonctionnelle. Si on dispose de ces informations pour certains neurones, pour d’autres, nos connaissances du rôle des nerfs cutanés chez l’humain sain et malade comportent de nombreuses zones d’ombre et ont besoin d’être complétées.